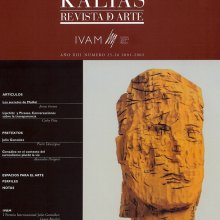
LUIS BARRAGAN
Auteur : LAURENT BEAUDOUIN
PUBLICATION D’UNE CONFÉRENCE DE LAURENT BEAUDOUIN SUR LUIS BARRAGAN AU MUSÉE DE VALENCIA (IVAM INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO) LORS DE L’EXPOSITION « LUIS BARRAGAN THE QUIET REVOLUTION »
LUIS BARRAGAN : L’ARCHITECTURE COMME POÉSIE
La modernité est une permanence réinventée, un éternel retour. L’architecture même la plus ancrée dans l’histoire est pleine d’exotisme, de fragments de voyages, de choses vécues, de souvenirs d’ailleurs et d’étrangetés. L’histoire est un art vivant. L’architecture est faite d’aller et de retour entre la pensée et la mémoire. Elle est faite du souvenir de ce que nous avons vu et de ce que nous avons été. L’architecture est une tradition qui se réinvente sans cesse à partir d’elle-même.
L’esprit moderne traverse l’œuvre comme un souvenir, la recherche de la permanence prime sur la nouveauté. L’architecture est une micro-géographie, elle crée un nouveau paysage par sa simple présence, elle peut faire d’un rocher une montagne et d’une flaque d’eau, une mer. De la géographie, elle a ses courbes de niveaux, ses lignes de crête, ses plateaux et ses failles, sa pente et ses lignes de fuites. Elle est dans cette faible pellicule qui sépare le ciel de la terre. Une œuvre d’architecture révèle les lignes d’un paysage endormi. Elle est à l’écoute d’une géographie où un simple accident, une petite perturbation peut quelques fois nous révéler des vérités plus lointaines. La micro-géographie à laquelle l’architecture doit être attentive est le début d’une nature qui se tient toujours à distance. Les grands paysages ont des prémices, que l’architecture devrait épargner. Où commence une montagne ? où est le début de la plaine ? sur quelle ligne s’appuie une colline ? L’architecture est un révélateur de ce qu’est le paysage.
L’architecture utilise une langue universelle comme la musique ou la peinture, une langue primordiale, une langue qui n’a pas besoin de traduction, elle est un langage qui parle de l’émotion, d’une émotion des premiers temps. L’architecture est un commencement, elle est originelle, comme une naissance continuelle. L’architecture est à la recherche d’un autre temps, celui de l’aube des jours, un temps du paradis, un moment où tout est découverte, un temps fondamental dont le commencement contient la certitude de sa fin. Chaque projet nouveau recommence pour lui-même la naissance de l’architecture et en contient toute l’histoire.
L’architecture fait partie des éléments du paysage, de l’univers du visible, d’un monde souvent utilisé comme modèle à imiter. L’architecture se définit à l’intérieur des phénomènes naturels, elle y prend part parce qu’elle provoque des perturbations. Elle est un projet sur la nature. Pourtant l’idée que nous nous faisons de la nature est changeante, sa connaissance varie avec le temps. La nature visible cache en surface un ordre invisible plus profond : la gravité, le temps, la lumière, le son, l’espace. Pour échapper à l’imitation des seules apparences, l’architecture compose aussi avec cette part cachée du réel, ces éléments invisibles qui procurent une autre source d’inspiration à notre langage. Le visible et l’invisible ne peuvent être compris séparément, ils s’interfèrent sans que nous puissions les séparer. Ce qui ne se voit pas n’est pas ce qui n’existe pas, le silence n’est pas l’absence de son et nous savons que ce qui est inaudible fait partie de la musique, ainsi l’architecture est dans ce qui se voit autant que dans ce qui ne se voit pas. Les intermédiaires visuels que sont les photographies ou les dessins ne sont qu’un fragment lointain et partiel de sa réalité, comme un reflet dans un éclat de miroir. L’architecture n’est pas une image.
L’architecture respecte la solitude, une solitude qui n’est pas l’isolement. L’architecture construit des lieux où la solitude peut s’épanouir, une solitude heureuse, où l’on se sent apaisé face à soi même. L’intimité profonde de la solitude n’est pas seulement dans la petite dimension, il est de grands espaces qui savent la préserver comme la mer et le désert. L’architecture sait donner une intimité aux grands espaces. Nous avons inventé la solitude pour nous préserver du trop plein d’un monde qui nous submerge. Pouvoir être seul parmi les autres est un des degrés de notre liberté.
L’architecture est sentimentale, elle est un lieu d’apaisement, elle rassure et console, elle est un refuge pour la pensée, un moment de repos pour l’esprit. Elle recueille nos méditations, les protège, elle les encourage, leur donne des couleurs. Elle entoure comme une mère le rapport intime de la pensée et du corps, elle construit un univers de sentiments, fait d’évocations multiples et de fragments de mémoire. Elle est le lieu où l’on peut, sans peur, être seul au monde. L’intimité n’est pas l’isolement, elle est la liberté d’être soi-même. L’architecture construit des intimités ouvertes, des intérieurs infinis.
Le silence n’existe pas. Il y a toujours du son. Il faut être silencieux pour en prendre conscience. Le son est toujours là, il n’a pas de commencement et pas de fin. C’est quand le son vibre plus ou moins que je l’entends, il fait partie d’une grande suite continue. Quand je m’arrête de parler, le son continue, quand la musique s’arrête, la première note vibre encore, elle intègre la continuité du monde. Dans la musique, les sons se superposent, se masquant petit à petit, le son n’est pas entendu en tant que tel, isolément, il résonne avec ceux qui le précèdent et accompagne ceux qui le suivent, la musique intègre la continuité de l’espace. Le corps entend les vibrations de l’air, lié à l’espace par la surface de sa peau, il en mesure la profondeur. J’écoute avec tout mon corps. Le son, comme la lumière, a besoin de la matière pour exister, comme elle, il se réfléchit sur les obstacles et se transforme dans les variations de l’air. Le son est né d’une vibration de la matière, il n’existe que par la fluidité de ce qui rempli l’espace. Nous entendons grâce à la plénitude de l’espace. La lumière m’aide à l’entendre, le son est comme elle, une ondulation qui s’échapperait dans l’inaudible s’il n’y avait la résistance de la matière pour le capter, comme la lumière qui s’enfonce dans l’invisible en l’absence d’opacité. Le silence est du son ralenti. L’architecture a besoin de moments de silence pour entendre, elle doit arrêter l’incessante vibration de l’air pour écouter, comme on fait silence pour entendre une musique. Le calme est un son intérieur. Le silence n’est pas l’isolement ou l’absence de bruit, le silence est solidaire des autres sons. L’architecture de Barragan sait écouter, être attentive au bruit du silence, comme la musique, son architecture donne une forme au son.
L’architecture résonne et s’étend simultanément dans l’espace et dans le temps, elle est un art de la durée. Le temps naturel et le temps social sont des temps différents qui apparaissent superposés, l’homme et la nature ne bougent pas à la même vitesse, l’espace naturel et le temps naturel ne sont pas les mêmes que l’espace humain et le temps humain, ces deux espaces et ces deux temps se superposent, mais en sont pas synchrones. Le temps de la nature est celui qu’il faut aux nuages pour changer de forme, à la mer pour couvrir une plage, à l’aube pour se lever. Le temps humain, lui nous apparaît comme un temps accéléré par rapport au temps naturel. L’architecture doit nous aider à gagner la perception de cet autre temps : le temps ralenti de la nature. L’architecture peut rendre ce temps visible : le temps du cadran solaire et le temps d’une montre ne sont pas les mêmes, celui de la montre décompte le temps humain, le temps immédiat, l’instantané, celui que l’on voit s’écouler rapidement. Il faut prendre plus de temps pour voir bouger l’ombre du cadran solaire. L’architecture est comme un cadran solaire sur lequel se projette patiemment le temps naturel. Le soleil en est le lent métronome, il modifie l’architecture avec douceur. L’architecture est une machine à ralentir le temps.
Le temps et la lumière sont de proches cousins. La lumière, celle-là même qui nous éclaire, a depuis toujours servi à mesurer le temps, la science a séparé la lumière et le temps pour mieux les comprendre nous privant de leur simultaneïté. La lumière est pourtant la marque concrète du déploiement du temps dans l’espace, elle est changeante, et son mouvement transforme le monde. Le temps se déplace dans l’espace visible, comme une projection d’ombre et de clarté. L’invention d’artifices différents pour répondre à ces deux fonctions nous a fait perdre cette relation vitale à la mesure naturelle du temps. La lumière de la nature fait partie de notre horloge interne. En moi brûle un peu du soleil, se dépense un peu de son énergie. Nous nous sommes entouré d’objets artificiels qui nous éloignent de cette réalité, instruments de mesure du temps qui, du sablier au chronomètre, en dramatise l’écoulement, l’accélère, le rend homogène et inéluctable. La poésie du temps est dans son incertitude, une mesure plus vague de sa dimension le dilate, l’élargit. Rendre visible la lenteur du soleil, est une manière de résister à notre aliénation par l’accélération du temps social. Il faut du temps pour voir. L’architecture est du temps ralenti.
L’homme seul est capable d’abstraction. Elle est une création mentale, elle n’est pas une transformation formelle qui nous éloigne de la nature, mais une façon de la rapprocher de nous à travers le filtre de la pensée. L’abstraction ne sépare pas l’homme de la nature, elle est la nature de l’homme, la capacité d’abstraire est ce qui nous singularise parmi les phénomènes naturels. Les deux polarités abstraites et concrètes ne sont pas contradictoires. D’une certaine manière, l’abstraction est devenue un élargissement de notre rapport à la nature. L’abstraction est une ouverture à la partie invisible du domaine naturel, à des lois encore inexplorées. Elle nous donne l’impression de pouvoir durer par la pensée, elle nous permet d’échapper à notre propre fragilité. L’introduction de l’abstraction dans les formes de la nature permet d’approcher une autre poétique visuelle. La lumière est-elle abstraite ou concrète ?, a-t-elle une épaisseur ?, a-t-elle un poids ?, peut-elle porter un bâtiment ? Répondre à ces questions, c’est donner à la lumière de la nature une visibilité plus grande. La lumière n’existe pas seule, elle n’est présente que dans sa confrontation à l’opacité de la matière. Associer deux lois de la nature, la lumière et la gravité par exemple rend l’une et l’autre plus présentes, donner du poids à la lumière ralentie son mouvement. La lumière devient grave. Elle s’installe alors dans une lente épaisseur. L’architecture est de la lumière concrète.
La lumière n’existe que dans sa rencontre avec l’opacité d’une surface, elle n’apparaît que grâce à un monde opaque. C’est l’obstacle de la matière qui la rend palpable, la transforme en volume, en épaisseur, en forme. C’est l’opacité et non la transparence qui la fait apparaître, qui la rend présente. Il n’y a pas de lumière sans opacité, comme il n’y a pas de cinéma sans écran. L’opacité recueille la lumière pour mieux nous la faire voir.
L’architecture est autant projet que projection, elle ne reçoit pas le jour au hasard, elle n’est pas seulement “sous la lumière”, comme le dit Le Corbusier, comme un acteur se tournant du meilleur coté pour recevoir le faisceau d’un projecteur. L’architecture respire du souffle de la lumière. L’éclat de la nature peut ainsi entrer dans le domaine des choses humaines à travers l’abstraction de la forme. Ce n’est pas toujours la lumière qui éclaire la matière, il peut arriver, comme dans une peinture de Matisse, que se soit la surface des choses qui devienne éclairage, que se soit elle qui donne une forme à un jour jusqu’alors impalpable, qui offre un devenir à la lumière et lui donne sa présence. La lumière est une “métaphore de la substance”. L’architecte dessine l’apparence de la lumière comme le peintre rend visible son tableau avec la touche du pinceau.
La peinture ou la photographie nous fait voir la profondeur là où il n’y en a pas. La profondeur est dans la superposition des objets, c’est-à-dire dans ce que je ne vois pas, dans le manque, l’effacement de ce qui est derrière. Si toutes les choses étaient côte à côte, entièrement visibles, l’espace serait plan. Si je sens la profondeur, c’est grâce aux parties des choses que je ne vois pas. L’invisible informe le visible. La profondeur est dans ce qui nous est proche, le lointain réunifie les objets, les rassemble dans une même surface, une montagne me parait au loin une seule et même forme, une masse unique, impénétrable. Ce qui est loin n’est pas profond. L’espace ne nous est pas donné dans sa totalité, j’ai la pré-science de ce qui est hors de ma vue, à travers la mémoire de ce qui m’est caché. Je garde la conviction que l’espace se poursuit derrière le mur, qu’il y a une continuité vraie, que le sol est là, même si je ne le vois pas, que je peux y aller sans tomber dans un gouffre. L’architecture me rassure sur la consistance du monde. Un peu de ce qui va arriver est dans ce qui vient de finir. Je pressens le futur de l’espace comme lorsque je devine la fin d’une mélodie en écoutant une musique. La mémoire conserve l’intuition du futur. L’architecture n’est pas dans l’instantané, elle est dans le successif. L’architecture est tour à tour portrait, nature morte et paysage.
Le corps est le protagoniste essentiel de l’architecture, il est l’interlocuteur. Il relie l’abstraction de la pensée, au concret de la nature. Le corps est clairvoyant, il peut sentir dans le monde réel ce qui est caché au-delà du domaine visible, laissant percevoir une résonance avec les lois invisibles du monde physique. Le corps est notre premier instrument de mesure, mais nous avons une connaissance faible de la conscience de nous-mêmes, nous devons apprendre à nous connaître comme on connaît un instrument. Le corps est capable d’entendre la musique des dimensions, cet instant où les mesures se mettent à résonner comme des cordes. La dimension concrète qui vibre avec les rapports d’échelle, résonne dans le corps en profondeur comme une musique.
La proportion n’est pas une règle statique, figée dans une simple vision frontale, le rapport des proportions perdure dans le mouvement, c’est le déplacement lui-même qui en provoque la vibration. L’architecture peut retenir cet espace qui nous fuit, elle peut en condenser des passages, en épaissir les seuils, stabiliser son vide, le remplir d’existence. Elle retient l’espace au moment de son dénouement quand il se résout enfin à devenir intériorité.
Il n’est ni dedans ni dehors. L’espace est unitaire, qu’on veuille l’enclore dans des murs, il reste le même. Le monde est une plénitude, un mur ne le sépare pas en deux, il reste un. L’important n’est pas le mur, mais la densité d’espace qui nous en sépare. L’architecture accompagne l’espace dans un mouvement continu, l’intérieur est un pli de l’extérieur. L’architecture forme avec le paysage un seul ensemble, comme pour le dessin apparent des étoiles d’une constellation, la distance les sépare mais notre regard les rassemble dans une figure unique. Le raccourci de la vision rassemble et unifie toutes choses, les absorbe dans un espace indivisible. Le paysage hors de la fenêtre appartient à la chambre autant que l’espace derrière le miroir.
L’espace n’est pas vide, il est une matière sans densité, une lumière sans opacité. Ce que je sens de l’espace est son absence de résistance, sa totale plasticité. Je suis habitué à son vide, cela ne m’étonne pas parce que je ne le vois pas. L’espace à besoin de points d’appuits pour être ressenti, l’espace et l’architecture sont dos-à-dos, elle lui donne sa présence, en lui donnant de la substance. L’espace est fluide, il a besoin d’être contenu. L’architecture est un microcosme intérieur.
L’architecture n’existe que dans sa réponse aux règles de l’univers, elle fait écran aux lois de la nature, les rendant visibles comme l’écran de cinéma rend visible la vapeur de lumière du projecteur. Sur l’architecture se reflètent des phénomènes qui ne seraient pas apparents sans la volonté de les révéler, de leur donner une forme. L’équilibre avec le monde naturel est ce qui nous maintient en vie, nous sommes dans un univers rempli d’inaccessible où la vie est comme une exception provisoire. Ce qui est vivant est un instant d’ordre dans la dissolution de la matière.
L’architecture est horizontale. L’homme est un être vertical, mais la ligne de nos yeux trace une horizontale. L’homme s’est fait dans ce rapport à angle droit. Ses yeux sont parallèles à l’horizon et un léger basculement de la tête lui donne l’équilibre, comme une bulle d’air dans un niveau de maçon. Notre tête articulée fait basculer un espace qui pourtant reste le même. La mer ne coule pas lorsque nous penchons la tête. Dans cet amour de l’horizontal, l’eau est la seule rivale de l’architecture. La ligne d’horizon en est la profondeur ultime. Nos yeux projettent un plan parallèle au sol, soulevé à un mètre et demi et c’est dans cette épaisseur que nous nous déplaçons. Nous sommes suspendus dans ce plan horizontal sans fin. Notre pensée flotte à la hauteur des yeux et nous avons construit pour y vivre un monde parallèle à cette surface imaginaire. La ligne d’horizon est garante de l’infinité du monde, de ce recul permanent qui nous éloigne de sa propre limite. La tension de la verticale et de l’horizontale est la structure de toutes choses.
La gravité n’est pas de l’ordre des choses visibles. La nature est à ce point organisée par la gravité que l’homme ne la sens pas, notre rapport à la terre est d’une telle évidence qu’il devient insensible. Il est dans la nature de la nature humaine d’être en équilibre. Le corps humain est pourtant vertical en dépit de la gravité, il n’est jamais immobile. Je marche, mais à chaque pas je tombe un peu et je me retiens de tomber. Je tiens debout, je marche, mais je ne me sens pas tomber, je ne sens pas l’effort que fait mon corps pour combattre la pesanteur. Mon corps n’est pas stable, il est en perpétuel rétablissement, il fait des mouvements pendulaires insensibles pour me maintenir sur cet axe qui me relie au centre de la terre, il travaille en permanence pour ne pas s’effondrer. La nature a eu la gentillesse de ne pas me faire sentir l’effort que je fais pour être vertical. L’architecture suit cette même règle, elle dialogue avec la gravité. La conquête de la verticale est un gain sur cette force invisible. La gravité, dans son évidence, n’est, pas plus que la lumière, une dimension palpable de la nature, elle n’est pas sensible par elle même, elle ne fait pas partie des choses du monde visible, d’ailleurs, pendant longtemps, pour nous, elle n’a pas existé.
L’architecture est à la fois un art du trait et un art du retrait. L’architecture est une mise à distance, elle est un moment de recul. Elle apparaît là où je ne suis pas. Où que j’aille, l’espace me précède. Ce recul qui permet à l’architecture d’être visible est en même temps ce qui m’en sépare, plus j’avance, plus l’espace semble fuir, se retirer du lieu où je suis, se redessiner plus loin. La vision est suspendue au mouvement. L’architecture est dans la maîtrise du déplacement, elle est une transition ininterrompue, une chorégraphie. L’espace n’en finit jamais de commencer, le corps se déplace indéfiniment à travers lui comme si je cherchais à en atteindre la fin, mais le monde se retire à chaque pas que je fais. Plus je bouge, plus j’avance, plus le monde semble reculer. Je vais vers un point qui s’enfonce dans l’infini Je veux atteindre un espace inaccessible, un lieu qui disparaît à chaque pas. Le monde est hors de ma portée, si bien que le mouvement lui-même devient l’objectif de ma recherche. L’architecture n’est pas un objet que je cherche à atteindre, elle est dans ce retrait de l’espace qui m’accompagne à chaque pas. Plus j’avance, plus elle recule, semblant se dilater ou se contracter en suivant mon propre mouvement. L’architecture est la danse du temps et de l’espace.
LAURENT BEAUDOUIN











