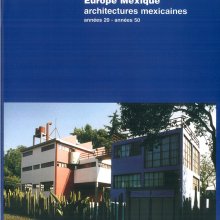
MATHIAS GOERITZ
Auteur : LAURENT BEAUDOUIN
TEXTE DE LAURENT BEAUDOUIN SUR MATHIAS GOERITZ A L’OCCASION DE L’EXPOSITION FRANCE-MEXIQUE
L’ÉCHO DE MATHIAS GOERITZ
Ce texte est un hommage amical à Mathias Goeritz, rencontré en 1984, qui m’a généreusement accordé sa confiance et prodigué ses conseils. La restauration de son œuvre majeure, le musée El Eco, est engagée en 2005.
Mathias Goeritz est un artiste protéiforme et inclassable. Cette singularité revendiquée fait de lui un des créateurs les plus étonnants et aussi les plus méconnus du XX° siècle. Son œuvre architecturale, en particulier, est la plupart du temps passée sous silence par les historiens qui ne le citent au mieux que comme un collaborateur de Luis Barragan. L’ambiguïté de son statut est à l’origine de cette méconnaissance, Goeritz fut tout à la fois historien, critique, sculpteur, peintre, créateur de vitraux, poète lettriste et architecte. De même est-t-il impossible de l’affubler d’une étiquette qui permettrait de le ranger dans les tiroirs de l’histoire de l’art, il y a toujours chez lui quelque chose qui dépasse. Il ne sera pas vraiment dadaïste ou expressionniste, bien que fortement marqué par ces deux mouvements, il ne sera pas non plus rangé dans le land art ou le minimalisme, les ayant devancés d’une dizaine d’années. Finalement Goeritz a fort bien réussi à atteindre cet anonymat qu’il cherchait à promouvoir dans des œuvres qu’il voulait collectives.
Après avoir quitté sa ville natale de Danzig, il va accompagner à Berlin une famille ouverte à l’art et aux idées progressistes. Dans ces années de formation, ce séjour à Berlin fut marquant par les rencontres qu’il a pu y faire et la confrontation au bouillonnement culturel qui précéda la montée du nazisme. Il a côtoyé de nombreux mouvements artistiques dont l’expressionnisme qui baignait l’ambiance du Berlin de son adolescence et qui restera en filigrane dans son œuvre. Mais le plus marquant pour lui fut le mouvement Dada qu’il a connu à travers ses voyages et ses lectures. L’œuvre et de la pensée du poète Dadaïste Hugo Ball l’accompagneront dans son travail, lui donnant un point d’appui auquel il se référa souvent. Ce n’est pas l’attitude provocatrice que Goeritz retiendra d’Hugo Ball, mais son ouverture d’esprit et son évolution spirituelle, dont le livre « La Fuite Hors du Temps » retrace le parcours. Le fondateur, avec Richard Hülsenbeck, du « Cabaret Voltaire » fut à ce point important, que de nombreuses années plus tard, Mathias Goeritz donna à son œuvre architecturale majeure le nom d’ « El Eco » en espérant insuffler dans son pays d’adoption, le Mexique, l’écho de ce Cabaret Voltaire de Zurich, où se confrontaient tous les arts dans un seul lieu. Dans cette période d’avant-guerre, Mathias Goeritz fut aussi frappé par l’intolérance et les persécutions subies par les juifs de Berlin. Il comprit très vite qu’il ne pourrait rester en Allemagne et commença en 1940 un exil qui le conduira finalement jusqu‘au Mexique. Le chemin de Berlin à Mexico fut cependant très long, passant par le Maroc et l’Espagne, où pour fuir la guerre, Mathias Goeritz, s’installa successivement. Au Maroc, Goeritz, et sa femme Marianne Gast, rencontrée à Tanger en 1941, découvrirent, comme tant d’autres, la puissance de la lumière, cette force qui transfigure les murs et transforme les couleurs. En Espagne, il s’installa dans un premier temps à Madrid développant une activité de critique d’art puis, lors d’un séjour à Santillana del Mar durant l’été 1948, il découvrit le site préhistorique d’Altamira. La découverte de ces figures primitives ouvrit la voie à la maturation de son travail: « Je trouvais ces peintures incroyablement modernes » dit-il. La découverte de ces figures rupestres, faisant appel à des émotions pures, entraînant le spectateur dans un rapport physique à l’œuvre, traça le chemin d’une modernité primitive. Ces formes sont pour lui comme des signes de fraternité dans cette Espagne où il s’est réfugié pour s’éloigner de la guerre. Avec un groupe d’artistes dont son ami le sculpteur Angel Ferrant, il va fonder l’ « École d’Altamira » qui sera le point de départ d’un renouvellement profond de l’art espagnol dont Tapiès et Saura seront les figures marquantes. Les idées lancées au sein de ce groupe vont être rapidement étouffées par le pouvoir politique et le milieu académique, qu’il n’hésite pas à provoquer, imposant à Goeritz un nouveau départ et un exil qui sera finalement le dernier.
C’est au Mexique qu’il trouve refuge en 1949, invité par l‘architecte Ignacio Diaz Morales pour enseigner à l’université de Guadalajara. Il va commencer au sein de l’école d’architecture, une pédagogie proche des cours du Bauhaus, qu’il poursuivra pendant de nombreuses années et qui lui permettra de se confronter à l’échelle architecturale et urbaine. Le Mexique devient pour lui le pays où tout semble possible. Le développement de la ville atteint une intensité étonnante et de grands projets, comme celui de la cité universitaire, sortent de terre à un rythme impensable pour un Européen qui n’a connu que des périodes de destructions. Le Mexique lui apparaît comme le pays des audacieux. Son premier choc culturel, Goeritz le reçoit dès son arrivée à Mexico quand ses amis lui font visiter les ruines précolombiennes de Teotihuacan. Goeritz a la révélation que la taille d’une œuvre a une influence sur l’intensité des émotions qu’elle provoque, à l’encontre des théories de l’art en cours en Allemagne. Ainsi une œuvre d’art n’aurait pas seulement une valeur indépendamment de sa taille, comme le suggère Wilhem Worringer dans son « Abstraction und Einfhülung » mais l’intensité émotionnelle semble, pour Goeritz, avoir un rapport effectif avec la dimension. Ce problème sera désormais au centre d’un travail qui le conduira vers des propositions d’œuvres monumentales.
Dès son arrivée au Mexique, il est présenté aux deux personnalités qui vont marquer sa vie: l’architecte Luis Barragan et le peintre Chucho Reyes. L’amitié et la complicité qui va naître entre eux seront à l’origine d’une production intense où les idées du peintre coloriste et les formes primitives du sculpteur vont se fondre dans l’œuvre de l’architecte. La collaboration entre Goeritz, Reyes et Barragan portera à la fois sur la conception de certains projets communs, comme les tours de Satellite City et sur l’installation d’oeuvres qui s’intègrent aux bâtiments et aux jardins. Dans leurs rapports à l’espace et à la lumière, les sculptures de Goeritz deviennent des pièces indissociables de l’architecture. Dans certains cas, comme les vitraux et l’autel de la Chapelle des Capucines, les œuvres de Goeritz font totalement partie du bâtiment et dans d’autres, elles agissent en contrepoint, comme pour le Serpent de béton qui marque l’entrée des jardins d’El Pedregal. Cette sculpture fait, en sorte, le lien entre le Mexique et les souvenirs d’Altamira. Elle fait partie d’une importante série représentant des animaux primitifs en bronze, en bois, ou en acier, qui va culminer avec le serpent abstrait d’El Eco.
En avril 1952, Mathias Goeritz expose ses sculptures à la galerie « Arte Mexicano ». Il y rencontre un étrange personnage, Daniel Mont, qui se dit intéressé par son travail et qui lui propose de réaliser une œuvre de son choix sur un terrain qu’il possède au centre de Mexico. Très incrédule, Goeritz se rend au rendez-vous fixé sur le site et y retrouve effectivement son mécène qui lui confirme la commande. Ensemble, ils vont définir ce qui sera un musée expérimental ouvert à tous les types d’art et dont le but sera d’exposer l’art vivant, invitant les artistes à réaliser des œuvres sur place. Le programme défini par Goeritz est le premier exemple de l’idée d’ « installation » qui va se développer à partir des années soixante. La construction, commencée en septembre 1952, fut menée à bien jusqu’à l’été 1953, mais le programme artistique fut interrompu par mort de Daniel Mont quelques mois après l’inauguration du musée. Aujourd’hui le bâtiment, profondément transformé, attend une restauration qui pourrait redonner une nouvelle vie à ce projet culturel unique.
Le bâtiment est une sorte d’« action building » construit à partir d’un schéma qui rassemble en quelques traits la façade, la coupe, le plan et la perspective. Cette représentation graphique unique n’est pas la moindre des inventions de Goeritz. Elle rappelle, d’une autre façon, les tentatives d’El Lisstzky pour figurer, en un seul dessin, tous les cotés d’un espace, mais évoque plus encore sûrement les recherches des peintres cubistes pour ramasser la profondeur sur un plan sans faire appel à l’illusion réductrice de la perspective. Ce dessin représente à la fois le lieu et le parcours du lieu, il est la synthèse du temps et de l’espace, il questionne aussi le rapport du plein et du vide, de l’opaque et du transparent. Ainsi peut-on voir la fenêtre de la cour à travers le mur vertical comme si le regard franchisait l’épaisseur du béton, ou la colonne noire de la salle d’exposition au-delà du mur du couloir. Cet étrange dessin nous montre ainsi le dedans et le dehors comme s’il était un seul espace rassemblant l’intérieur et l’extérieur dans un même regard.
Au fur et à mesure du chantier, Mathias Goeritz traça au sol la position et l’épaisseur des murs et en détermina la hauteur, modifiant certains aspects en cours de chantier. Le bâtiment est séparé de la rue par une tour, haute et sombre, derrière lequel s’élève un autre mur, étroit et haut de onze mètres, entièrement peint en jaune. La tour jaune s’élève comme une lame énigmatique qui éclaire l’intérieur de la cour. À droite de cette verticale, fixée sur le mur qui sépare la cour de la rue, une petite inscription calligraphiée en acier « El Eco » indique la présence de l’entrée. En poussant la porte pivotante, on entre dans un univers différent, où les repères visuels changent. À gauche, une ouverture sur le mur de la cour éclaire l’espace d’une étrange lumière jaune. Ce n’est pas la lumière solaire qui éclaire l’intérieur, mais une lueur transfigurée par la couleur, comme si elle provenait du mur lui-même. Un poème abstrait se détache en relief sur le mur ajoutant à l’étrangeté du lieu. Il est illisible au sens propre et pourtant reste poème, comme si la forme se substituait au sens. Les poèmes plastiques de Goeritz sont les échos lointains des textes des russes Kroutchonykh et Khlebnikov et de leur poésie « zaoum », ce langage à l’écoute des sons que les surréalistes français vont, d’une certaine manière, reprendre à leur compte dans l’écriture automatique. Les figures calligraphiées de Goeritz vont au-delà du langage et se passent du son lui-même pour proposer une écoute visuelle où le silence est implicite. Le silence est nécessaire à cet espace en rupture avec l’agitation de la ville. Le « Poème Plastique » est à la fois le début et la fin d’El Eco, il se voit dès l’entrée derrière la grille de la fenêtre et peut se contempler à la fin du parcours en spirale du bâtiment, lorsque l’on se retrouve au pied du mur jaune. La figure du bâtiment est ainsi une forme ouverte et sans fin, elle n’est pas fermée comme la spirale d’un coquillage, à l’inverse, elle s’ouvre de plus en plus depuis l’entrée étroite, jusqu’à une large et haute salle, pour finir dans une cour ouverte au ciel. L’espace s’échappe vers le haut en suivant la direction verticale du mur jaune, après avoir zigzagué dans la cour, comme un ballon qui se dégonfle, en suivant la ligne brisée de la sculpture d’acier. L’ensemble forme un anneau de Moebius où l’espace s’engouffre à nouveau à l’intérieur par la fenêtre de l’entrée et se glisse dans le couloir vers la grande salle, pour se dilater encore une fois dans le patio extérieur. Cette boucle continue rappelle, dans un mode géométrique, l’ « Endless House » que son ami Friedrich Kiesler commence à imaginer à partir de 1947.
Immédiatement après l’entrée, un long couloir crée l’espace de transition voulu par Goeritz entre le bruit de la ville et l’atmosphère de contemplation qu’il veut donner à l’intérieur. La galerie est longue et l’on aperçoit à l’extrémité un petit torse de femme en bois sculpté, porté par un socle en fines tiges de fer. Tout l’espace semble conduire vers cette figure dans une perspective vertigineuse qui évoque les trompe-l’œil baroques ou les perspectives accentuées des décors de théâtre. Mais c’est pourtant au cinéma que cet espace se réfère le plus, évoquant les films expressionnistes que Goeritz a dû voir dans sa jeunesse. Cette étrange perspective est due au resserrement progressif des murs, à l’abaissement du plafond et à l’élévation simultanée du sol. Les lames en bois du plancher accompagnent le rétrécissement de l’espace et semblent se diriger vers un objet infiniment lointain: le petit torse de femme qui flotte dans la lueur du fond. C’est la seule courbe de ce bâtiment dont l’espace est pourtant une spirale sans fin. Les formes du torse n’ont pas non plus de commencement ni d’achèvement, elles sont le point nodal de l’édifice, comme si elles concentraient en elles toute l’énergie. Le rôle de moteur spatial que Goeritz accorde à cette sculpture est confirmé par l’idée exprimée dans la description qu’il fait de l’édifice où il envisageait de projeter l’ombre de la sculpture sur le mur latéral, là où sera finalement la grisaille d’Henri Moore. De belles photographies montre Goeritz et la danseuse Pilar Pelicer réglant une chorégraphie, lui-même tournant et dansant autour d’elle. D’autres images montrent la même danseuse à côté de la sculpture comme si elle en avait été le modèle. Aux courbes voluptueuses des deux torses, correspond la danse de l’espace que Goeritz a chorégraphié autour d’elles.
Une ombre sur le côté latéral de l’ouverture interrompt pourtant la profondeur. C’est une tour de sept mètres de haut peinte en noir qui n’est aperçu que partiellement depuis l’entrée et qui ne se révèle totalement que dans la salle d’exposition. Ce second mur forme un couple avec celui de la cour, ensemble ils associent à travers la couleur, l’ombre et la lumière, le dedans et le dehors. Contrairement aux catégories de couleurs et de non-couleurs définies par Mondrian, pour Goeritz, le noir est une couleur. Il va ne laisser dans la catégorie des non-couleurs que le blanc et le gris, ainsi le noir et le jaune sont à chaque extrémité de sa ligne chromatique. Goeritz va d’ailleurs bientôt remplacer le jaune par l’or, comme pour confirmer cette hypothèse, le noir et l’or deviennent ainsi les deux aboutissements de sa gamme colorée.
La fascination de Goeritz pour les tours date de sa visite à San Geminiano, lors de ses voyages de jeunesse, mais c’est en parcourant New York qu’il va voir se confirmer ce qui va devenir une sorte d’obsession. New York est pour lui la plus grande sculpture au monde, une de ces œuvres anonymes et monumentales dont il rêve. Ainsi, il va commencer avec El Eco une série de projets verticaux dont le plus célèbre sera le groupe de tours de Satellite City, construit avec Barragan et Reyes sur la base des maquettes que Goeritz a présenté à Mario Pani, l’urbaniste chargé de la réalisation de ce nouveau quartier de Mexico. Ce projet, aujourd’hui célèbre, transforme la vision cinétique de l’œuvre en associant le mouvement et le regard. Ce que recherche Goeritz est le changement visuel des volumes au fur et à mesure du déplacement. On y retrouve ainsi les recherches engagées à El Eco. Les tours sont perçues successivement comme des prismes à plan carré puis comme des murs sans épaisseurs, ou comme des triangles aiguisés. Il en va de même de leur hauteur qui n’est jamais stabilisée et qui semble varier suivant que l’on les regarde depuis le bas ou depuis le haut du site.
C’est néanmoins dans son propre atelier à Temixco que Mathias Goeritz réalisera en 1956 l’ensemble de tours le plus étonnant et à mon sens le plus abouti. Il va réunir dans un espace rectangulaire simple, sept volumes prismatiques sérés les uns contre les autres au point de ne laisser qu’un faible passage entre eux. Le sol est en terre battue, les murs et les tours sont peints en blanc et l’unique fenêtre forme un grand carré à l’origine sans vitrage, ouvert sur le jardin. L’ensemble est formé d’un cylindre vertical, d’un prisme à base carrée qui lui fait face et de cinq prismes à base triangulaire plus ou moins aiguë qui paraissent danser autour d’eux. Les volumes semblent s’entrechoquer sans se toucher, il y a dans cette salle une extrême tension qui vous absorbe comme si l’on flottait dans une œuvre blanche de Malevitch. Les tours ne sont pas strictement verticales et semblent pencher et vaciller, elles paraissent alternativement se rapprocher puis s’écarter les unes des autres dans une sorte de danse incessante. Le mouvement de l’espace accompagne le déplacement du corps dans un déséquilibre permanent comme une lente chorégraphie. Ce travail sur la densité et la verticale évoque avant l’heure les œuvres que d’autres sculpteurs comme Richard Serra vont réaliser à partir des années 1970. El Eco est avec ses deux tours la prémonition d’un vaste courant qui va traverser le siècle.
La salle d’exposition d’El Eco, grande et haute, n’est pas destinée à recevoir des œuvres, comme dans une galerie d’art, mais plutôt le travail des artistes, regroupant des projets qui devraient êtres réalisés pour ce lieu et dont l’installation devait être accompagnées de manifestations multiples. Ainsi en a-t-il été de la fête d’inauguration, le 7 septembre 1953, mise en scène par Luis Bunùel, auquel participait un groupe de jazz et la troupe de danse de Walter Nicks. La première œuvre installée trois mois plus tard fut une grisaille d’après des dessins du sculpteur Henri Moore. Elle représente d’impressionnantes figures verticales dessinées au trait et dont la composition d’ensemble est soulignée par la superposition d’un grand tracé régulateur géométrique. La salle est éclairée sur la cour par une unique ouverture, un carré dont la menuiserie trace une croix, seul angle droit du bâtiment. La porte-fenêtre est réalisée suivant les conseils de Luis Barragan qui en avait construit une semblable pour sa propre maison en 1947.
En plus des deux tours, qui forment un couple purement abstraits, Goeritz associe les deux sculptures du torse et du serpent, placées elles aussi à l’intérieur et à l’extérieur et qui, pour le lecteur assidu de la Bible qu’est Goeritz, sont évidemment une évocation de l’épisode de la Genèse. El Eco est ainsi une sorte de paradis isolé du monde par un mur, un paradis avant la faute initiale, ou le serpent et la femme sont séparés par la croix de l’unique fenêtre. La lecture mystique d’El Eco montre à quel point ce bâtiment à pour Goeritz l’importance d’un temple pour ce qu’il va nommer « l’art-prière » et qu’il va opposer à « l’art-merde » vers lequel il sent que se dirige une partie de l’art contemporain.
Dans cette cour d’El Eco, l’immense « Serpent » d’acier trace des figures dynamiques qui donnent à l’espace une dilatation nouvelle. Cette sculpture réalisée l’hiver 1952 est la préfiguration de l’art minimal qui va se développer dans les années soixante à partir des œuvres de Tony Smith. Malgré l’évocation d’un animal préhistorique, métissé d’Altamira et d’art précolombien, la sculpture est essentiellement abstraite, posée sans socle, à même le sol de terre cuite. Sa valeur est dans l’émotion physique qu’elle produit par sa taille et la force de son rapport aux murs qui l’entoure. L’émotion architecturale est le moteur du projet d’ « El Eco », elle est au centre du travail de Mathias Goeritz, expliquant la très grande diversité de ses recherches. Pour lui, comme pour beaucoup d’artistes modernes, l’émotion a remplacé l’idée du beau. La beauté classique, basée sur le sentiment du plaisir, n’étant perçue que comme une partialité parmi des gammes d’émotions qui peuvent aller du positif au négatif. Ce basculement de l’idée du beau à été décrit par Ozenfant dans un texte de 1926, proposant « une beauté sans signe » : « l’art a bien pour fin le beau, mais le beau sans signe, c’est-à-dire une certaine nature d’émotion intensive que chacun pour son compte ressent dans chaque cas particulier comme agréable ou désagréable, mais jamais avec indifférence. »(1) Cette primeur de l’émotion se retrouve également chez Le Corbusier, elle est au centre des malentendus qui ont marqué sa vie. Pris entre une architecture académique dénuée de sens et les défenseurs d’un fonctionnalisme réducteur, attaqué sur ce plan à la fois par ses amis et par ses ennemis, comme lors de la célèbre polémique avec Karel Teige, Le Corbusier est obligé d’exiger à la fois que l’architecture fonctionne comme une machine doit fonctionner, c’est la moindre des choses, mais également qu’elle soit le creuset des émotions.
Mathias Goeritz rédigera pour l’ouverture d’El Eco son propre manifeste: «Arquitectura Emocional »(2) qui sera lu au moment de l’ouverture et publié en 1954 dans la revue de l’Ecole d’Architecture de Guadalajara. Ce texte est à la fois une description du bâtiment qu’il vient de réaliser et un texte-programme sur lequel il bâtira la suite de son œuvre :
« Le nouveau « Musée Expérimental » El Eco à Mexico commence ses activités, c’est-à-dire ses expérimentations, avec l’œuvre architectonique de son propre édifice. Cette œuvre fut comprise comme l’exemple d’une architecture dont la principale fonction est l’émotion. L’art en général et naturellement aussi l’architecture est un reflet de l’état spirituel de l’homme dans son temps. Cependant l’impression existe que l’architecte moderne, individualiste et intellectuel, exagère parfois, peut-être a-t-il perdu le contact étroit avec la communauté, dans sa volonté de mettre en exergue la partie rationnelle de l’architecture. Le résultat est que l’homme du XX° siècle se sent écrasé par tant de fonctionnalisme, par tant de logique et d’utilité dans l’architecture moderne. Il cherche une issue mais ni l’esthétisme extérieur entendu comme « formalisme », ni le régionalisme organique, ni le confusionnisme dogmatique ne sont confrontés au fond du problème qui est que l’homme créateur et récepteur de notre temps, aspire à quelque chose de plus qu’une belle maison agréable et adéquate. Il demande ou demandera un jour à l’architecture et à ses moyens matériels modernes, une élévation spirituelle, ou plus simplement une émotion, comme lui en ont procuré en son temps l’architecture de la pyramide, celle du temple grec, de la cathédrale romane ou gothique, ou même celle du palais baroque. C’est seulement en recevant de l’architecture des émotions vraies que l’homme peut à nouveau la considérer comme un art. Issu de la conviction que notre temps est en proie à de hautes inquiétudes spirituelles, le musée El Eco ne veut pas être plus qu’une expression de celles-ci, aspirant un peu inconsciemment, mais presque automatiquement, à l’intégration plastique pour prodiguer à l’homme moderne une émotion maximale.
Le terrain d’El Eco est petit, mais grâce à des murs de sept à onze mètres de hauteur, à un long couloir qui va se rétrécissant, avec une élévation du sol et un abaissement du plafond, on a essayé de donner l’impression d’une plus grande profondeur. Les lattes de bois du sol de ce couloir suivent cette même tendance, elles se rétrécissent et se terminent presque en un point. En ce point final du couloir, visible depuis l’entrée principale, on envisage de placer une sculpture : un cri, qui doit trouver son écho dans une peinture murale, « grisaille » d’environ cent mètres carrées, obtenues si possible par l’ombre même de la sculpture qui devra se projeter sur le mur principal de la grande salle. D’un point de vue fonctionnel, on a sans doute perdu de l’espace par la construction d’un grand patio. Mais celui-ci était nécessaire pour faire culminer l’émotion obtenue dès l’entrée. De plus, il doit servir pour des expositions de sculptures en plein air. Il doit donner l’impression d’une petite place fermée et mystérieuse, dominée par une immense croix qui forme l’unique porte-fenêtre. Si à l’intérieur, un mur haut et noir, détaché des autres murs et du toit, devait donner la sensation réelle d’une hauteur exagérée, hors de la « mesure humaine », dans le patio, il manquait un mur encore plus haut, compris comme un élément sculptural de couleur jaune, qui, comme un rayon de soleil, entrait dans l’ensemble, dans lequel on ne trouve pas d’autres couleurs que le blanc et le gris. Dans l’expérience d’El Eco, l’intégration plastique n’a pas été comprise comme un programme, mais dans un sens absolument naturel ; il ne s ‘agissait pas de superposer tableaux ou sculptures à l’édifice comme on le fait souvent avec des affiches de cinémas ou avec les banderoles qui pendent des balcons des palais . Il fallait comprendre l’espace architectonique comme un grand élément sculptural sans tomber dans le romantisme de Gaudi ou dans le néoclassicisme vide allemand ou italien. La sculpture, comme le « serpent » du patio devait devenir une construction architectonique presque fonctionnelle, avec des ouvertures pour la danse, sans cesser d’être sculpture et donner une tonalité de mouvement inquiet aux murs lisses. Il n’y a presque aucun angle à 90° dans le plan de l’édifice. Quelques murs sont même fins d’un côté et épais de l’autre. On a voulu retrouver cet étrange et presque imperceptible asymétrie qu’on observe dans la construction de n’importe quel visage, de n’importe quel arbre, de n’importe quel être vivant. Il n’existe pas de courbes aimables ni de sommets aigus. Le tout fut réalisé dans le lieu même, sans plans exacts. Architecte, maçon et sculpteur était une même personne. Je répète que toute cette architecture est une expérience, qui ne veut pas être plus que cela. Une expérience qui a pour but de procurer à l’homme, dans l’architecture moderne, des émotions psychiques sans tomber dans une décoration vide et théâtrale. Elle veut être l’expression d’une libre volonté de création qui, sans nier les valeurs du fonctionnalisme, essaie de les soumettre à une conception spirituelle moderne. L’idée d’El Eco est née de l’enthousiasme désintéressé de quelques hommes qui ont voulu donner au Mexique le premier « Musée Expérimental » ouvert aux inquiétudes artistiques du monde contemporain. Les conseils de Luis Barragan et de Ruth Rivera ont été précieux. De même un appui essentiel est venu des élèves des cours « d’éducation visuelle » de l’Ecole d’Architecture de Guadalajara. Il faudrait les remercier tous ainsi que les ingénieurs Francisco Hernandez Macedo, Victor Guerrero et Rafael Benitez ; les peintres Carlos Mérida et Rufino Tamayo ; le musicien Lan Adomian ; les maçons et les peintres ; les plombiers et tous les ouvriers. Ils ont investi du temps, prodiguant leur aide par des conseils ou par des interventions lorsque cela était nécessaire. Je pense qu’eux non plus n’ont pas perdu leur temps. (2)
Transformé en salle de spectacle, dans les années 60, peu après la disparition de son fondateur, Daniel Mont, le musée El Eco avait vu son patio couvert et son intérieur profondément dégradés. Il a fallu attendre l’année 2004 pour que l’Université de Mexico (UNAM) décide d’acquérir les locaux et engage un programme de rénovation pour aboutir à une ouverture qui a eu lieu le 7 septembre 2005. Le projet est encore en attente de la réinstallation de la sculpture « La Serpiente » essentielle à l’espace du patio. Même si cette rénovation n’a pas échappée aux polémiques récurrentes depuis la reconstruction du pavillon de Barcelone de Mies Van Der Mies Van Der Rohe, il faut saluer l’initiative de l’UNAM qui aboutit à la renaissance d’un des bâtiments majeurs de la modernité.
(1) Amédée Ozenfant. « Sur les Ecoles Cubistes et Post-cubistes ». Journal de Psychologie Normale et Pathologique. 1926. Réédition Bottega d’Erasmo. Torino 1975.
(2) Mathias Goeritz. « Arquitectura Emocional. El Eco ». Cuadernos de Arquitectura N°1. 1954.
Laurent Beaudouin.









