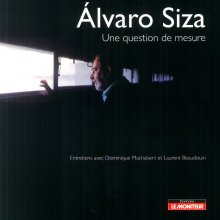
SIZA : UNE QUESTION DE MESURE
Auteur : LAURENT BEAUDOUIN, DOMINIQUE MACHABERT
ENTRETIENS AVEC ALVARO SIZA
“L’ARPENTEUR”
En 1972, paraît dans la revue italienne Controspazio un court article de Vittorio Gregotti sur un architecte portugais inconnu, accompagné de photographies en noir et blanc. On y voit les fragments d’une architecture énigmatique, sans rien de spectaculaire; il en émane au contraire un sentiment de tranquillité un peu figée. Une ombre passe avenue dos Combatentes à Porto, l’image est floue et en arrière-plan, il n’y a même pas de maison, juste un mur et un portail. De l’habitation que l’on veut nous montrer, on ne voit, au fond, que la découpe. L’architecture n’a pas d’expression, elle est comme le portrait d’une femme vue de dos qui regarde un jardin. Le peintre dévoile une silhouette qui ne nous laisse pas voir son visage et nous voilà fascinés par cette absence, imaginant son sourire et la beauté de ses traits. Finalement il faut se contenter de l’avant-scène, et l’on se rend compte que l’architecture est bien là, dans ce premier plan qui ne saute pas aux yeux. On comprend après coup que la part d’expression de la maison est assumée par ces seconds rôles, un simple mur et un portail, l’examen des esquisses confirme ce transfert. Le personnage principal, lui, restera énigmatique jusqu’au bout, jusqu’à ce que l’on nous invite à l’intérieur. Le mur en béton brut, au sable apparent, s’abaisse vers le sol pour devenir une bordure courbe qui s’infléchit vers le jardin. Le portail, d’une blancheur abstraite, se soulève au contraire de quelques centimètres pour venir se poser sur de minuscules pilotis. Ce léger soulèvement, qui préserve l’acier de la corrosion, a comme effet d’accentuer la faible pente de la rue. Par une simple ligne horizontale, Siza souligne une micro géographie imperceptible. Dans d’autres projets, la différence est quelquefois si faible que le doute s’établit, jusqu’à insinuer que l’horizon bascule, ou que le plan d’eau d’une fontaine s’incline. Ici, les deux courbes du portail et du mur s’entrecroisent pour accompagner poliment le visiteur vers la porte d’entrée, c’est l’attitude d’un architecte qui a le sens de l’urbanité. Plus loin dans le même numéro de cette revue, apparaissent des plans de bâtiments étranges, au premier regard très éloignés de l’expression retenue dont faisait preuve le premier. L’article se termine par un édifice de forme concave, dont les centres multiples se déplaceraient vers l’extérieur de sa propre géométrie; ainsi, avant même d’entrer, on est déjà dedans. Les dessins énigmatiques de cette banque à Oliveira de Azeiméis, à peine lisibles, articulent des volumes qui semblent s’ouvrir en éventail. C’était sûrement un souvenir d’Alvar Aalto et comme un fait exprès, l’architecte s’appelait Alvaro.
Je dois dire que ce petit article, déniché à la bibliothèque de l’école, a été le point de départ de ma vie d’architecte. Quelques années plus tard, la révolution nous a rappelé que ce pays, si proche, vivait sous la dictature. En juin 1976, Bernard Huet retrace dans l’Architecture d’Aujourd’hui l’activité de ceux qui, comme Siza, s’engagent dans le renouveau du pays et particulièrement dans la rénovation des quartiers populaires. C’est l’aventure des SAAL. (1) Dans ce même numéro, Vittorio Gregotti et Oriol Bohigas évoquent le travail d’Alvaro Siza dans deux textes qui resteront prémonitoires. Pour les étudiants que nous étions, lassés d’un enseignement trop théorique, l’attirance pour cette œuvre engagée dans la réalité était une planche de salut. Lors de notre rencontre initiale, peu après la révolution, les premiers chantiers de logements sociaux étaient amorcés et, déjà, certains allaient s’interrompre. C’est Bouça dont la construction ne sera achevée que trente ans plus tard, c’est aussi São Victor. Ce dernier projet, commencé en 1974, reste à ce jour inachevé ou peut-être inachevable. Dans ce quartier d’ilhas, habitations pauvres surplombant le Douro, parmi les anciens murs de granit, Siza avait glissé une première ligne de logements. Elle émergeait du site comme une figure abstraite, d’un vert très pâle souligné par les traits bruns des fines menuiseries d’acier et les aplats orangées des stores en toile. Devant ces premières maisons, des fragments de pierre, préservés avec soin, prenaient une valeur antique. Le contraste entre la géométrie instantanée des parties neuves et la force des anciens murs donnaient à l’ensemble une densité temporelle. La topographie, à laquelle Siza avait accordé une place majeure dès ses premières œuvres, était soulignée par le glissement des lignes d’acrotère et le décalage progressif des murs séparatifs. Sur l’arrière, une maison jamais construite aurait permis de traverser l’îlot et, plus loin, un petit théâtre de rue devait occuper un angle de mur. Ces vestiges, aujourd’hui disparus, étaient le support de jeux intimes et de secrets d’enfants.
Je me suis rendu compte, plus tard, que cette époque de travail et d’enthousiasme était éphémère et que ces bâtiments, d’une délicatesse merveilleuse, étaient d’une grande fragilité. L’arrêt de ce projet a été une perte terrible pour la ville et pour ses habitants. Cette architecture était plus intense dans sa capacité d’évocation que dans sa volonté d’expression. La nécessité de la forme, ou même de la simple présence de l’architecture, ne se faisait pas toujours sentir. L’invention, l’idée constructive, la force énigmatique de l’image, pouvaient se contenter d’être là quelque part et de ne pas être partout. L’effort n’était jamais montré et l’intensité de l’ensemble pouvait se trouver dans un seul fragment. De ce travail subtil, à la limite du visible, Siza parle peu, comme s’il gardait en lui ses secrets pour ne pas qu’ils s’échappent.
À cette époque, une équipe soudée de jeunes étudiants l’entourait. Ils resteront proches, comme lui-même le sera, auprès de son maître et ami Fernando Tavora. Ils sont tous aujourd’hui des personnalités majeures de l’architecture portugaise, soit par leur œuvre propre, soit par l’aide qu’ils lui apportent sans compter. Siza rendra toujours hommage cette équipe de collaborateurs fidèles et compétents. Eduardo Souto Moura et Pie, sa femme, bien sur, mais aussi Adalberto Dias, Nuno Lopes, Antonio Madureira, José Paulo Santos puis Carlos Castanheira, Luis Mendes, Avelino Silva, Paulo Sousa et bien d’autres que je ne connais pas. Tous forment autour de lui une « dreamteam » avec laquelle il continue souvent de travailler après leur départ et qui permet à son propre atelier de rester d’une taille raisonnable. Ainsi, il n’y a pas de projet qu’il ne contrôle parfaitement, non seulement dans la réalisation, mais surtout dans le choix même des sujets qu’il accepte d’étudier. Alors qu’il refuse de nombreux projets prestigieux, parce qu’il pense que les conditions ne sont pas réunies pour les réaliser correctement, il peut accorder un temps considérable à des projets d’une échelle infime mais, qui, à ses yeux, ont une importance sociale ou culturelle. Le meilleur exemple est le travail discret conduit sur une longue période avec Roberto Collova pour aménager quelques rues et la place d’une église en ruine à Salemi en Sicile, un autre est celui, difficile, développé au Cap-Vert pour préserver quelques fragiles maisons traditionnelles. Cette attitude, je ne l’ai jamais retrouvée chez d’autres architectes touchés par le succès. Siza a su rester lui-même, sans modestie particulière mais avec détachement, insensible aux flatteries et inflexible devant ce qui peut corrompre son travail.
LA VILLE-PAYSAGE
C’est bien loin de Porto, dans la banlieue d’Évora que Siza va trouver l’occasion d’une mise en scène à grande échelle de son sujet préféré: la géographie. On l’a vu travailler en arpenteur, en topographe, en géomètre, on va le voir agir en chorégraphe, utilisant le territoire comme une scène où se croisent des gens et quelques animaux. L’horizontale et l’oblique des réseaux en aqueducs vont entrer en contraste avec la déclinaison graduelle des maisons pour révéler la mouvance du sol, il invente la danse d’une ville-paysage, où l’on est à la fois le spectateur et le danseur. Cette géographie naturelle, explorée à l’échelle urbaine se retrouve dans des endroits secondaires, des lieux presque fragiles, des jardins minuscules ou des places à la marge de l’existant. C’est de la sorte qu’il conçoit l’aménagement d’une esplanade qui s’étend devant une école, en bordure du nouveau quartier. Sur la longueur, le sol semble presque plat; pourtant, la surface de la place s’installe en creux dans le terrain naturel. Elle commence par une dalle de marbre gravé, incrustée dans un sol de petits pavés irréguliers; puis, sur un des côtés, une ligne de granit borde toute la place, s’élevant petit à petit pour devenir muret. Seuls des emmarchements presque tous différents révèlent cette infime variation. À l’autre extrémité, c’est une double rampe qui rejoint le niveau naturel. La relation étroite entre l’architecture et la topographie donne l’impression que la place est là depuis toujours, comme gravée dans le sol. Cette sensation de permanence est produite également par le traitement des jardins en quasi-continuité avec le paysage rural. Il en va de même des rues qui, grâce aux infrastructures aériennes, ne sont pas encombrées des habituels accessoires dont se pare la ville moderne: regards qu’il vaut mieux ne pas regarder, trappes de visites à ne pas visiter, coffrets électriques, grilles en tout genre, parsemées sans cohérence et qui, dans nos villes, sont l’objet de réparations incessantes et coûteuses. Le pavage de granit de Malagueira est vierge, ressemblant davantage à des chemins de campagne qu’à des rues de banlieue. La ville est conçue comme un paysage naturel.
ÉLOGE DE LA MESURE
Un des traits de caractère le plus sensible de Siza lors des entretiens est son attachement au bien commun. C’est la leçon amicale qu’il donne sans en faire une profession de foi, à l’opposé de l’encouragement à l’individualisme qui est dans l’esprit du temps; c’est aussi la part la plus courageuse de son travail et peut-être la plus incomprise. Pour lui, la ville ne peut être seulement l’accumulation d’individualités. À chaque situation correspond la capacité d’un bâtiment à marquer, ou pas, sa présence dans la ville, ses projets sont produits par la substance même des lieux où ils sont construits. Ils ne sont cependant pas totalement contextuels et s’il les nourrit des formes, des typologies, des techniques constructives, glanées au fur et à mesure de ses voyages, il ne craint pas l’importation d’idées exotiques, s’appuyant sur une histoire de l’architecture qui est aussi celle des grands voyageurs. Il travaille à partir d’un lent processus d’immersion à travers des promenades incessantes, des regards attentifs et interrogateurs qui finissent toujours en croquis rapides. Pourtant la technique n’est jamais exprimée pour elle-même, les principes constructifs et les détails changent peu d’un lieu à l’autre. Pour Siza, le langage n’est que murmure.
En 1980, les études menées à Berlin dans le quartier de Kreutzberg, à l’invitation de Brigitte Fleck, sont un exemple de cette attitude. Le salut à la “tristesse” du langage architectural est un peu comme le reflet de la mélancolie qui donne à cette ville son caractère. La forme même du bâtiment de Schlesisches Tor, son aspect sensuel et fantomatique, rappellent qu’aucune reconstruction ne saurait effacer totalement la part tragique de l’histoire de la ville. La présence, partout entrevue, des grands pignons de pierre, laissés à vif après les bombardements, fait entièrement partie du Berlin d’aujourd’hui, comme les toitures en zinc sont inséparables de l’atmosphère de Paris. Le petit passage vide entre ce bâtiment d’angle et le pignon de l’immeuble voisin accentue cette tension entre le présent et son histoire. La nouvelle construction ne referme pas complètement la plaie et ne recouvre pas ce qui, sans doute, restera comme une cicatrice. Mais le même bâtiment parle aussi du Berlin d’aujourd’hui avec ses enfants turcs du quartier de Kreutzberg, pour qui cette ouverture a un autre sens. L’îlot de l’immeuble voisin possède une perméabilité qui rejoint les multiples et successives différences de statut des quartiers traditionnels. Il préserve des espaces ouverts à l’usage collectif, quelquefois au détriment d’une fragile architecture qui devient ainsi accessible aux artistes de rue. Ce travail à Berlin est exemplaire de l’idée que Siza se fait de la ville. Ses autres projets urbains, au Chiado ou à Montreuil, vont eux aussi s’appuyer sur la force poétique de l’existant; le déjà-là nous parle de ce qui va arriver, il veut libérer la part de futur qui est dans le présent. «Je suis sensible au moment qui va suivre» dit-il dans notre premier entretien.
DESSINER PAS À PAS
Le croquis est chez Siza une manière d’être. Il ne lui sert pas à représenter le projet, il lui sert de regard; c’est le dessin qui contemple l’espace pour montrer à son auteur ce qu’il doit être. Siza n’a pas besoin d’hétéronymes comme le poète Fernando Pessoa, il a cette main qui est un autre lui-même, elle lui tient compagnie et lui raconte ce qu’elle pense de son projet. Elle le connaît tellement bien qu’elle est habituée à ses tics et à ses petites manies, il semble qu’elle s’amuse à le surprendre par des écarts permanents. Elle a une telle autonomie qu’elle peut se permettre de ne pas faire «du Siza», comme pour le pousser dans ses derniers retranchements, elle l’entraîne dans des hypothèses improbables, auxquelles sûrement il n’aurait pas pensé tout seul. Comme elle ne le quitte pas et qu’il l’emmène partout avec lui, elle ne se gêne pas pour griffonner en permanence; sa passion à elle, c’est le dessin; quant à lui, peut-être préfère-t-il fumer une cigarette en regardant pensivement ce qu’elle vient de faire. Cette hypothèse se confirme lorsque de temps en temps, il dessine ses mains comme si elles étaient celles d’un autre, comme s’il était étranger à son propre corps; spectateur étonné devant cette main capable de croquis d’une beauté stupéfiante pendant que l’autre lui-même regarde la télé. Ce que crayonne ce couple singulier est à chaque fois un questionnement sur l’existence; le dessin n’est pas là pour simuler un espace, il le fait exister, il recherche une présence. Sans doute est-ce la raison pour laquelle les esquisses sont habitées de nombreux personnages, occupants hypothétiques ou anges de passage, jeune fille entrevue ou cyclistes pressés, quelquefois des animaux, des chevaux surtout, que, comme Barragan, il aime représenter. De temps à autre, il en chevauche un, gaillardement, maigre Don Quichotte à l’assaut des moulins avec un petit couteau en guise de lance.
Le dessin invente le lieu qu’il représente, en avançant pas à pas vers ce qui reste encore inconnu. C’est une quête qui semble sans cesse inachevée. Siza dessine pour voir ce que le plan et la coupe ne lui disent pas, puis il en fait faire des maquettes pour vérifier le rapport des volumes entre eux. Son attirance va vers ce qui est presque impossible à représenter et donc à concevoir. Les carnets sont aussi des confidents où les obsessions s’écrivent page après page. Quelquefois des thèmes passent d’un carnet à l’autre sans autre lien qu’une idée qui devient brusquement récurrente. Ils relient les souvenirs de voyage aux projets en cours. C’est peut-être l’explication de l’apparition soudaine dans son œuvre de passerelles en béton suspendues en l’air, empruntées poliment à l’architecte brésilienne Lina Bo, ou aux derniers projets de Niemeyer et qui se retrouvent du musée de Porto Alegre au théâtre non réalisé de Montreuil en se posant à Madrid pour saluer Picasso. Les carnets lui tiennent lieu de journal de bord et recueillent les souvenirs de voyage et les poésies secrètes. Des traces de ces pérégrinations sont transcrites d’un projet à l’autre, insufflant aux œuvres un parfum d’exotisme, cet exotisme qui a toujours imprégné l’architecture, au temps des compagnons voyageurs ou des grandes découvertes.
LA TOPOGEOMETRIE
L’origine géométrique des tracés complexes qui sous-tendent les projets de Siza est à rechercher dans la géographie du lieu ou, occasionnellement, dans son histoire. La source généralement centrifuge de ces lignes s’ancre le plus souvent sur des tracés extérieurs aux bâtiments et s’appuie parfois sur des repères presque insignifiants ou quasiment effacés. Le travail de Siza met au jour des structures invisibles au premier regard par une analyse presque archéologique du réel, une archéologie du présent. Cette résurgence de l’origine des formes va bien au-delà du bâtiment pour questionner le terrain tout entier. Dans la banque d’Oliveira de Azeméis, par exemple, le travail de transformation successive du projet depuis son point de départ, inspiré de la bibliothèque de James Stirling, jusqu’au dessin définitif, a été un patient tissage géométrique créant des liens complexes avec la réalité. Son tracé répond, comme un écho, à des éléments singuliers du quartier et repose sur des points de convergence ou des lignes tangentielles. L’objet construit à la fin de ce lent processus semble être une pure création abstraite, dont la figure répond en apparence à une origine intérieure ou à une certaine logique fonctionnelle. Pourtant il établit une résonance avec le lieu et les édifices voisins, auxquels Siza dit prêter attention sans faire de tri qualitatif, sans accorder de valeur particulière à des critères de beauté ou de patrimoine, attaché à leur seule présence. Il produit et intègre des reflets de la morphologie du site, donnant au vide qui sépare les bâtiments une réalité perceptible, une épaisseur tangible. Cette géométrie en mouvement associe l’espace et le temps ou, plus exactement, donne du temps à l’espace. La succession décalée des lignes droites de la piscine de Leça da Palmeira par exemple, ou la déclinaison des courbes de la banque de Vila do Conde, sont l’expression d’une expansion spatiale de la durée; le temps est modulé au long du parcours. En liant l’espace et le mouvement, Siza crée des lieux impossibles à décrire sans y avoir été. Un de ces endroits troublants est l’escalier d’entrée du pavillon Carlos Ramos dans la Faculté d’Architecture de Porto. En gravissant les marches, on ressent une impression mystérieuse, une émotion physique provoquée par la progression dans cet espace triangulaire, mais plus troublante encore est la sensation de déplacement des éléments architecturaux eux-mêmes. Ils semblent bouger en même temps que le spectateur, jusqu’au buste de bronze du palier qui, sur son socle incliné, lui fait comme un signe de tête en guise de bienvenue. Plus bas, dans les bâtiments de la Faculté d’Architecture, une autre émotion attend le visiteur dans la galerie d’exposition; sa structure invisible, donne à la lumière une dimension impalpable et irréelle, qui le baigne dans une atmosphère fluide, mouvante et temporelle. Pas mécontent de cette trouvaille, Siza invite Le Corbusier à y jeter un œil dans un de ses croquis. La lumière, l’espace, le mouvement, la gravité se mêlent dans cette salle comme un hommage à la nature impalpable. En effaçant toutes les autres dimensions, celles qui sont de l’ordre du visible, du végétal, du purement terrestre, tellement présentes dans les autres parties du bâtiment, où chaque morceau du paysage est successivement mis en scène, Siza donne brusquement à méditer sur la réalité des forces naturelles, celles que l’on ressent sans les voir, celles qui sont cachées par la force de l’habitude.
LE BESTIAIRE APPRIVOISÉ
Siza est aussi un maître de l’étrangeté. Il n’est pas seulement le topographe attentif que je viens de décrire; certaines œuvres invitent à découvrir des figures insolites, visages d’amis ou animaux de toutes sortes: canard, tatou, girafe, éléphant tout un bestiaire vient peupler ses bâtiments pour créer une atmosphère énigmatique, comme ces animaux qu’enfants nous cherchions à deviner dans les images d’Épinal. C’est ainsi qu’une baleine blanche se trouva échouée dans le centre de Vila do Conde. Son corps à double courbure n’a que deux faces au lieu des quatre côtés d’un bâtiment traditionnel, sa peau souple et blanche est marbrée sur le ventre. Posée à livre ouvert, la pierre est utilisée pour sa couleur délicate et son épaisseur lumineuse, presque charnelle. À l’approche du bâtiment, on prend conscience de la différence de matière entre son socle en marbre rosé et les soubassements en granit des maisons voisines. Par cette substance fluide couvrant paradoxalement l’élément le plus stable du projet, Siza dédouble le sentiment de légèreté du rez-de-chaussée, augmentant l’effet de flottement du volume blanc. Il crée une échancrure opalescente dans l’opacité de la ville. Le repli des parois extérieures fait pivoter l’espace de la rue vers la petite place en contrebas. Cette continuité des deux faces qui se retournent sur elles-mêmes, donne à l’espace intérieur une largeur et une fluidité inattendue. C’est une des figures géométriques les plus fortes qu’ait utilisé Siza, et pourtant elle se révèle paradoxalement une des plus attentives au contexte urbain. Plutôt que d’avoir choisit l’intégration mimétique dans le voisinage immédiat, le bâtiment s’appuie sur cette étrange métaphore pour construire son propre paysage et s’adresser au profil de la ville. Malgré sa petitesse, l’émergence de l’édifice est un écho aux monuments qui dominent Vila do Conde, non par bravade mais par volonté de clarifier la hiérarchie urbaine.
Pour échapper à l’immédiateté, à l’instantané et de ce fait, introduire la profondeur du temps, Siza développe autour du projet un rapport stratégique à l’espace vide, au creux, à la distance. La perception d’un écart entre le construit et l’existant prend alors valeur de projet. Il est rare, par exemple, qu’il choisisse la mitoyenneté, préférant, comme à Berlin, un frottement avec le vide. Ainsi, il devient impossible d’en rendre compte par la photographie parce que ce qui est derrière le photographe est aussi important que ce qui est devant ou au-dessus. Le déplacement du corps et cette impression de ralentissement du temps donnent à l’architecture sa plénitude; les vides sont d’une telle intensité qu’on s’y déplace comme si l’on nageait dans la fluidité d’une épaisseur lumineuse. Siza est étonnamment sculpteur quand il est architecte et finalement très architecte quand il devient sculpteur, sa première passion.
D’autres projets accentuent l’idée de durée par des éléments répétitifs au risque de l’habituelle accusation de monotonie. Siza y répond dans une interview avec Dominique Machabert au journal Le Monde à propos du Chiado à Lisbonne: “Peut-on parler de monotonie? C’est l’apparente monotonie des bâtiments qui constituent la ville, qui accentue la beauté des monuments, des bâtiments majeurs. À Lisbonne, la richesse topographique est telle qu’on ne peut pas à proprement parler de monotonie. Certes La Baixa est systématique, préfabriquée, monotone si vous voulez, mais le dessin architectonique n’est pas tout. Il fonctionne avec la topographie, la spécificité des monuments, avec le mouvement des gens, de la foule qui passe, etc. Ça c’est l’architecture, c’est la ville”. (1) La répétition telle qu’elle est mise en oeuvre chez Siza est une suite au sens musical du mot, c’est-à-dire qu’elle accepte ou même provoque les différences et les variations. Pour celui qui sait regarder, rien n’est vraiment pareil, la répétition exalte la plus petite différence. Elle est aussi présente comme une image de la communauté. Les murets de São Victor, les voiles et les escaliers de Bouça, les fenêtres de Berlin, les patios d’Évora, tous marquent la reconnaissance d’une identité collective. Cette dimension politique du travail de Siza ne s’appuie pas sur des dogmes, à aucun moment, elle n’est évoquée directement dans nos entretiens, c’est un engagement fondé sur l’action et la persévérance…
1977
ARTICLE PUBLIÉ PAR LA REVUE AMC
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi existe-il jusqu’à présent dans les revues d’architecture des articles sur vous mais pas d’article de vous ?
Mon expérience professionnelle n’est pas assez riche et globale pour me permettre de théoriser ce que je fais. Jusqu’à une période récente, j’ai fait des petits travaux qui sont des réponses à des problèmes de détails qui ne justifiaient pas d’être théorisés. J’avais la préoccupation, le désir de bâtir, mais les projets étaient de petits projets. C’est un peu pour ça, non ? Écrire des textes, ça n’avait pas de rapport avec mon travail.
Que pensez-vous du terme d’architecture “conjoncturelle“ utilisé par Vittorio Gregotti dans son article (1) pour désigner votre manière de composer un projet ?
Je pense qu’il veut dire qu’il n’y a pas un langage préétabli. Gregotti l’interprète très bien dans la partie finale de son texte, comme l’interprète très bien aussi le poète portugais Fernando Pessoa quand il écrit dans un poème : “Ce que je suis, ce que je fais, ce que je ne suis pas capable de faire, c’est comme une terrasse, une terrasse qui donne sur autre chose, c’est cette chose qui est belle“. Quand Gregotti parle d’architecture “conjoncturelle“ cela signifie pour moi que c’est une architecture qui n’a pas un langage établi et qui n’établit pas un langage. C’est une réponse à un problème concret, à une situation en transformation à laquelle je participe sans fixer à l’avance un langage architectonique, parce que mon travail est simplement une participation dans un mouvement de transformation qui a des implications beaucoup plus larges.
Le rapprochement que fait Gregotti entre votre manière de projeter et celle de Robert Venturi est assez nouveau du point de vue de la critique parce qu’il dépasse la simple analogie formelle…
Ceci est lié un peu à la question précédente. Je pense que ce n’est pas nouveau du point de vue de la pratique architecturale, mais peut-être est-ce nouveau du point de vue de la critique parce qu’il y a des rapports qui ne sont pas formels mais qui sont des rapports entre des attitudes de pensée. C’est important d’attirer l’attention là-dessus et c’est ce que fait Gregotti.
Ce lien avec Venturi se comprend mieux lorsque l’on connaît l’admiration que vous portez tous les deux envers Alvar Aalto. Pourtant vous n’y avez pas trouvé le même type de complexité que celle dont parle Venturi.
…Avec des raisons qui sont pour moi très claires. Les meilleures œuvres d’Aalto ont été réalisées après la guerre, dans une période où un grand mouvement collectif tentait de relever la Finlande de ses ruines, et d’affirmer son identité. Les œuvres d’Aalto de cette période, par la capacité qu’il avait de comprendre et d’être impliqué dans ce mouvement, reflètent toute la complexité tout l’effort d’un pays. Pour moi, c’est le grand moment d’Aalto.
La complexité dont parle Venturi n’est qu’une complexité formelle…..
Oui, mais la complexité formelle naît de la complexité réelle, non ? Sinon ce serait une abstraction. Je pense qu’il n’est pas possible d’inventer une complexité, c’est trop abstrait. Dans le cas d’Aalto, c’est la conjonction entre une complexité réelle, un effort collectif de reconstruction et un architecte qui a beaucoup de références, dans un pays un peu éloigné du point de vue culturel des grands centres artistiques comme Paris. Il a su faire un recueil de tout çà et s’en servir comme d’un outil dans un contexte qui permet d’en faire une application qui va dans le sens des intérêts collectifs. C’est un moment rare pour un architecte.
Beaucoup d’architectes font des complexes par rapport aux références qu’ils utilisent. Vous semblez par contre les manipuler sans problème. Quel est votre apport critique vis-à-vis de cette question ?
Si on peut parler d’un apport critique… Les références sont les instruments que possède un architecte, c’est son patrimoine de connaissances, d’informations. Il n’y a pas de raison de faire des complexes. Elles sont la somme de toutes les expériences qu’il est possible de connaître, et que l’on peut employer. Dans un contexte concret, l’architecte utilise ces instruments en fonction de ce contexte, alors ce n’est pas une position critique, c’est l’utilisation la plus sage possible dans un contexte donné.
L’architecture traditionnelle portugaise est d’une grande richesse. Pourtant vous semblez prendre une certaine distance par rapport à elle. Est-ce par peur du pittoresque ?
C’est un peu la même chose que pour les références. Ce patrimoine de la tradition portugaise est utilisable par rapport à des problèmes concrets. Ce qui est valable, ce qui est utile, il faut s’en servir. Ce qui n’est que romantisme n’est pas intéressant. Il y a eu au Portugal à la fin des années 50 un effort de connaissance de l’architecture traditionnelle dans ses rapports avec le pays tel qu’il est. Le livre qui est paru après cela (2) a été très influent dans l’évolution de l’architecture au Portugal et a été un peu récupéré pour faire des projets pour le tourisme… Pour nous ce qui était important c’était la connaissance du pays, des diverses cultures et des rapports entre la vie des gens et l’habitat. C’est une information, une connaissance très utile, très importante, mais pas plus. Ce n’est pas un modèle formel. Je n’accepte pas l’influence de l’architecture traditionnelle comme modèle formel, mais comme une expérience très longue d’adaptation au milieu, reflétant également les transformations de ce rapport. Comme ça, cela m’intéresse. Comprendre les rapports entre forme de vie et architecture est très utile, non pas pour imaginer des propositions d’organisation d’espaces, mais pour comprendre les problèmes concrets d’une société.
Quel a été pour vous l’importance de votre travail chez Fernando Tavora (3) ?
Fernando Tavora a été mon professeur, mais il a été plus que ça : un compagnon de travail, même à l’école. Ce n’est pas courant. Aujourd’hui, c’est la même chose, les problèmes qui intéressent les étudiants sont les mêmes que ceux qui l’intéressent. C’est un architecte très important pour l’évolution de l’architecture au Portugal, on le trouve toujours au centre des préoccupations actuelles. Par exemple, il a travaillé pour le S.A.A.L. (4) ; Il y a beaucoup d’architectes de sa génération qui ont travaillé au S.A.A.L, mais lui y était naturellement parce que c’était une possibilité d’intervention historiquement valable. Il faudrait étudier l’œuvre de Tavora qui est peu connue, sauf par ses collaborateurs et ses élèves. Je pense le faire un jour pour faire une exception et écrire quelque chose.
Aujourd’hui, la mode est plutôt à l’ « école » néo-rationaliste qui fait suite aux recherches de Rossi. Que pensez-vous de son succès auprès des jeunes architectes ?
Au Portugal l’œuvre de Rossi n’a pas autant d’influence qu’ailleurs. Après le 25 avril, les étudiants et les architectes ont eu une expérience d’action directe très importante. À Porto, par exemple, presque tous les étudiants ont travaillé au S.A.A.L. Rossi fait des recherches globales sur la ville et l’architecture qui sont très importantes pour des étudiants qui n’ont pas ce contact direct. C’est une recherche sur la transformation de la ville qui est faite en parallèle avec la réalité. On parle quelquefois des dangers d’académisme à propose de l’œuvre de Rossi. Je pense qu’il n’y a pas de danger. Mais son travail prend une certaine distance par rapport à la réalité. C’est un travail en parallèle. Comme celui des moines qui, après la chute de l’Empire Romain, préservèrent la culture dans les bibliothèques des couvents, et qui, tout en restant un peu à l’écart des transformations réelles et quotidiennes ont préparé un renouvellement.
Votre position est différente ?
Oui, parce que je travaille dans un contexte très différent. Et je pense que l’expérience récente au Portugal, qui nous a plongé dans le travail pratique, manque d’une certaine sûreté du point de vue théorique. Le support théorique est très important pour un travail pratique…. Ce qui s’est passé durant un séminaire à Santiago de Compostelle fut très intéressant parce qu’il y eut un choc entre l’École de Rossi et les étudiants espagnols et portugais qui étaient plongés, surtout les Portugais, dans une pratique expérimentale absente des propositions de Rossi. Ces conflits dans les premiers jours du séminaire furent à la fin très enrichissants ; ce fut la rencontre de deux choses différentes. Et, bien qu’il manquât peut-être une certaine recherche théorique de structuration pour les Portugais et les Espagnols, et une expérience pratique à l’École de Rossi, cet échange d’expériences a été très utile et très important.
Propos recueillis le jeudi 08 septembre 1977 à Porto par Christine ROUSSELOT et Laurent BEAUDOUIN.
1991 L’Architecture d’Aujourd’hui N° 278. Décembre 1991.
Vous avez souvent insisté sur le fait que votre travail n’utilise pas de langage codifié, pré-établi, et pourtant votre écriture et vos œuvres sont parfaitement reconnaissables.
Cela varie d’un projet à l’autre, cela dépend des programmes, des sites etc…. Au commencement même du projet et quelque fois avant de visiter le site, et d’en avoir une connaissance approfondie, j’essaie de trouver une idée, une image qui contienne ce que je sais déjà. Je dois dire que le fait de travailler dans des villes différentes constitue pour moi un stimuli. Si je fais un travail à Paris, alors, je dois visiter Paris en profondeur, c’est une ville magnifique, très variée. Cela déclenche des idées et ouvre des directions possibles pour le projet qui sont plus tard disciplinées par l’étude approfondie des problèmes. C’est la constante que je vois, l’importance du site. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas des liens quelque fois surprenants, même pour moi, entre des projets faits dans des sites différents. Il y a parfois des raisons évidentes pour cela, par exemple l’esprit du projet de Salzbourg est proche de la maison à Baia, c’est la topographie qui veut cela, en raison de la grande différence de pente. Quelque fois, je n’en suis pas très conscient, ainsi lorsque j’ai présenté pour la première fois le projet de l’école de Setubal, quelqu’un au cours du débat qui suivit la présentation, m’a parlé des rapports qui lui paraissaient évidents du point de vue de la forme, entre Setubal et le couvent du Cap Espichel qui est dans la même région. Je n’y avais jamais pensé mais j’ai dit, oui, c’est vrai. C’est probablement la reprise d’une forme inconsciente.
Le meilleur apprentissage pour un architecte, c’est de voyager, de voir des choses directement. Je me rappelle que le premier projet qui utilise la forme d’une proue, est une maison, ici à Porto, au bord du fleuve. C’était avant le projet de La Haye, mais je n’en suis pas sûr. Quand j’ai travaillé à La Haye, cette forme est venue dans une des deux petites maisons. Là, sûrement, il y a eu l’influence des formes assez courantes dans les années 30 à Amsterdam ou à La Haye. Ce n’est pas une copie, cela apparaît dans le brouillard de la création d’une idée. J’essaie de capter certains invariants qui existent dans toutes les villes et qui persistent à travers les siècles. A Berlin, je me rappelle avoir vu un bâtiment que je pensais en construction avec la forme courbe du projet de “Schlessisches Tor” et d’avoir dit soudain que quelqu’un était en train de faire une copie du bâtiment d’angle, après seulement, j’ai vu que c’était un bâtiment en démolition, que très probablement je l’avais déjà vu moi-même parce qu’il était situé dans le même secteur. On ne peut pas créer des formes sur rien.
On dit quelques fois de certains cinéastes qu’ils font toujours le même film. Est-ce qu’en ce qui vous concerne vous avez le sentiment de faire toujours le même projet avec des évolutions d’un bâtiment à l’autre, ou pensez-vous qu’il y a des périodes de rupture dans votre travail ?
Peut-être y a-t-il des ruptures parce qu’il arrive qu’il y ait des impulsions suffisamment fortes pour vous pousser à aborder quelque chose à laquelle vous n’aviez pas touché auparavant. Dans une certaine mesure, il y a une charge personnelle, une complicité, qui rend reconnaissable le travail de tel ou tel architecte et dans mon cas, je ne dirais pas qu’il y a des ruptures, mais plutôt des petits changements assez remarquables, à certains moments importants de ma vie. Je pense par exemple que l’expérience longue, intense et difficile du travail à Berlin, m’a ouvert d’autres voies par rapport à ce que je faisais jusqu’à cette date.
Quand on regarde, par exemple, deux projets contemporains comme Setubal et le château d’eau d’Aveiro, on voit d’une part, un travail très raffiné, très chargé formellement, et d’autre part, à Aveiro, une œuvre absolument rigoureuse, totalement abstraite. On a l’impression qu’il y a dans votre travail des directions de recherches qui sont finalement différentes.
Le thème d’un château d’eau n’est pas celui d’une structure qu’on expérimente de l’intérieur, c’est un objet dans le paysage. Au contraire, une école est un bâtiment où l’on a une vie sociale et aussi une vie d’étude individuelle. C’est un bâtiment à habiter intensément. Mais je vois, quand même, des rapports entre les deux bâtiments, peut-être à travers les questions importantes abordées au moment de la collaboration avec l‘ingénieur qui est mon partenaire depuis longtemps et qui aime discuter comme moi des structures. Je me souviens, par exemple, des conversations que l’on a eues sur Aveiro, où je posais une hypothèse et il disait: ça non. Il m’expliquait pourquoi et comment combattre, résister au vent. Ainsi, petit à petit, on a construit cette image, avec des apports des deux côtés. On peut dire qu’il y a eu rencontre, dialogue, entre deux recherches parallèles. C’est beau de travailler comme cela avec un ingénieur car c’est comme si nous devenions une seule personne. Je pense qu’il est possible de deviner que les mêmes personnes ont travaillé sur les deux projets d’Aveiro et Setubal. Je trouve très bien de devoir travailler avec d’autres sur des spécialités qu’on ne domine pas. Tous nous avons la tentation facile de l’inutile, qui nous pousse à prévoir des choses qui ne servent à rien et qui à la fin sont laides. Quand on examine un bâtiment qui n’a pas tellement de qualité, on trouve toujours qu’il y a des choses qui sont là sans raison. Je me rappelle, par exemple, que dans le portique de Setubal, j’avais fait des esquisses qui me semblaient très bien, où les pilotis se finissaient avec un couronnement en chapiteau. L’ingénieur m’a dit: “je n’ai pas besoin de ça”. Je lui ai répondu: “Mais c’est beau, il faut le faire”. Alors on a fait un essai. Quand je l’ai vu sur place, c’était vraiment horrible, peut-être parce que j’avais parlé avec l’ingénieur. J’ai dû faire une gymnastique pour réussir à convaincre le maître d’ouvrage de remplacer ça ! Ils ont dû démolir et faire sans ces choses ! Une grande partie de ces détails gratuits qui rendent le dessin affreux, on ne les fait pas quand on travaille de près avec un ingénieur qui vous est proche et qui apporte une discipline rigoureuse.
Il y a dix ans, vous insistiez sur les rapports multiples que pouvaient entretenir le projet et son contexte. Est-ce que vous n’avez pas donné petit à petit plus d’autonomie à votre architecture par rapport au site, en lui accordant plus d’indépendance ?
Basiquement, fondamentalement, je pense que je n’ai rien changé à ce point de vue. Je suis peut-être plus vieux, j’ai plus d’expérience et moins d’esprit d’aventure. C’est possible. Ce qui se passe, c’est que j’ai eu récemment des projets qui, par nature, ont une certaine autonomie. On ne choisit pas toujours la commande, alors j‘ai fait pendant des années des bâtiments qui ont un rôle assez secondaire dans la rue ou dans le paysage, et on ne peut pas faire un éléphant d’une fourmi. Par contre, il y a des travaux, qui par nature, à cause du programme ou pour des raisons topographiques doivent avoir une certaine autonomie. Par exemple, quand j’ai eu à étudier le projet d’une banque au centre de Vila do Conde, dans cette petite ville qui se transforme d’une manière affreuse et qui, en même temps, comme alibi, impose un conservatisme stupide dans le cœur historique, il était normal que ce projet atteigne une certaine autonomie. Il ne s’agissait pas d’ignorer les bâtiments d’à côté ou le profil de la ville, mais il fallait obtenir une lecture claire par rapport à cette forme d’évolution urbaine. Par contre, dans un autre contexte, pour la reconstruction du Chiado à Lisbonne, dans un quartier où l’incendie de 18 bâtiments n’avait rien changé quant à la vocation de ce secteur de la ville, sauf peut-être en accélérer une rénovation qui était irréversiblement nécessaire, là, il n’y avait pas de raison de faire des bâtiments qui se détachent du contexte, excepté pour ceux qui dans une certaine mesure se détachaient déjà.
Il me semble qu’un des outils conceptuels que vous utilisez dans les projets urbains, est la mise en tension du construit et du vide qui vous permet de constituer des espaces qui semblent être tenus sans donner l’impression d’être fermés ?
Cette sorte de tension existe dans toutes les villes, surtout dans les centres où il y a de profonds changements, des dégradations et en même temps des volontés de démolir, des volontés de spéculer ou des volontés de préserver à outrance etc…. Ces tensions là, qui semblent être une condition moderne, j’aimerais m’en libérer jusqu’au point de les ignorer complètement. Mon désir est toujours de chercher la rencontre de la sérénité. C’est pour moi un objectif à suivre, et c’est un but probablement difficile à atteindre, et qui peut même probablement devenir une erreur. En ce moment, par exemple, je suis assez préoccupé au sujet de la faculté d’architecture de Porto, parce que je suis parti sur la base d’un plan où il existait des rues, des lignes de trafic fort, des espaces libres. J’ai travaillé, dessiné, planifié, dans ce contexte, aussi bien que je le pouvais; j’ai cherché un équilibre en pensant toujours à la beauté de ce bord du fleuve, qui était encore parfait à cet endroit parce qu’il n’était pas construit, ou mieux, il était construit mais pas avec des bâtiments. Les bords étaient constitués de terrasses adaptées sagement à la topographie. J’ai pensé, alors, travailler en équilibre avec tout cela dans un des derniers sites à Porto où les bords du fleuve pouvaient être régénérés et préservés. Au contraire, pendant la construction, il y a eu des changements profonds de la part de l’administration de la ville, des rues ont été déplacées, des espaces préservés ne l’ont plus été, etc…. Maintenant que le bâtiment est presque fini, on ne sait toujours pas où seront les rues. Peut-être que l’amphithéâtre naturel qui existe devant le bâtiment va-t-il disparaître parce qu’une rue qui était derrière l’école risque d’être déplacée devant le bâtiment. Je suis désespéré avec ce qui se passe là. Certains disent que c’est une erreur de compter sur un tel équilibre. Je dois reconnaître que l’on travaille au milieu d’une instabilité terrible, tragique, qui rend difficile tout attachement à la sérénité, à la tranquillité, à l’équilibre. Cette qualité correspondait pour moi à un moment, je ne dirais pas universel, mais assez généralisé. Je pensais que c’était l’occasion avec le projet de la faculté d’Architecture de retrouver dans les temps modernes, cette beauté que l’on peut voir dans les gravures du XVIIIème. Peut-être que je me suis trompé.
Dans vos projets urbains, comme ceux de Berlin ou de Sao Victor à Porto, vous travaillez la notion d’îlot à l’encontre des volontés actuelles de fermeture et de reconstitution d’une parfaite continuité des rues.
Pourtant, je n’utilise pas cette idée de rendre les intérieurs d’îlots collectifs, traversant, comme un principe. Cela me semble trop simpliste, trop linéaire. Il faut dans la ville des points presque préservés, d’autres semi-publics, d’autres d’utilisation massive, etc… comme cela se passe aussi dans une maison. Il y a beaucoup de différences dans la forme et l’utilisation des îlots suivant les villes. Il faut les reconnaître et les prendre en considération dans le projet. Pour donner un exemple : à Berlin, depuis des siècles, au moins deux, il y existe des grands îlots dont le cœur n’est pas totalement privé. Il y a toujours des équipements à l’intérieur, il y a des espaces accessibles, des usines, des églises quelque fois et il y a d’autres îlots qui sont réservés et privatifs. C’est un continuum d’espaces, très sensibles à différentes formes d’utilisation qui vont du public au totalement privé, ce sont des divisions délicates. J’ai essayé, surtout avec le second travail de Schlessisches Tor, de poursuivre une reconnaissance profonde de ces conditions historiques et aussi de tenter une utilisation de cette forme de vie particulière. A Porto dans le quartier populaire de Sao Victor, l’intérieur était pratiquement public, mais au moment du projet, c’était une situation historique très spéciale avec les évènements que l’on connaît, une révolution, une prise de pouvoir des associations d’habitants, rien à voir avec Berlin. Ces études reflètent un attachement à des choses qui sont en dehors des stricts problèmes de dessin. Ces projets ont en commun la recherche d’un travail en collaboration avec presque toute la population locale, même à Berlin où il y avait beaucoup de conflits dans le quartier de Kreuzberg, avec une population très dense, à haut pourcentage d’immigrés. C’est un grand travail d’équipe qui ne peut être que fondamental pour l’évolution de l’architecture. Je m’intéresse toujours à ces problèmes qui étaient tellement à la mode au milieu des années 70, non seulement pour des raisons idéologiques, mais basiquement à cause de l’architecture même. En Hollande, j’ai pu défendre et réaliser quelques unes de ces idées parce que j’avais cet appui qui n’était pas préconçu ou hypocrite comme c’est habituellement le cas dans les discussions avec les promoteurs. Aujourd’hui quand on parle de quelqu’un qui veut travailler avec la participation des habitants, c’est comme si l’on parlait d’une chose très ancienne, démodée, immédiatement égale à une mauvaise architecture. Cet espèce de zig-zag des modes en architecture est une chose épouvantable, qui affecte beaucoup les résultats.
Certains critiques ont fait le rapprochement entre votre travail pour la construction du quartier de Malagueira à Evora et l’architecture des Siedlung allemand construits dans les années 30, qui correspondait aussi à une situation sociale particulière.
Au point de vue du style, je ne vois aucun rapport. En ce qui concerne le développement d’un grand secteur d’habitation avec la préoccupation de l’intégration d’équipements pour faire que ce secteur de ville ne soit pas un dortoir, là il peut y avoir des rapports. A Evora, tout est parti d’une décision politique de construire pour des coopératives un nouveau quartier en continuité avec la ville historique. Par contre, il y a eu des conditions de réalisations absolument spéciales et même anormales. Pour être concret, il n’y avait pas d’ouvriers pour construire les maisons et pas de matériaux non plus. Quand on a commencé il n’y avait pas de briques, pas de cuivre, etc… Alors, il a fallu se baser sur ce qui restait des techniques et des matériaux traditionnels, mais pas totalement, parce que les capacités de production n’étaient pas suffisantes. Par exemple, je ne pouvais pas utiliser les briques artisanales de l’Alentejo parce que la production est assez lente. Ils ne pouvaient pas répondre à des programmes de 300 ou 500 maisons. Il y avait aussi des contraintes économiques terribles avec un prix au mètre carré pour chaque maison très insuffisant. Je n’ai pas utilisé non plus des typologies traditionnelles. Le patio, par exemple, n’existe pas en Alentejo sous cette forme. Il est utilisé ici pour atteindre un certain degré de confort avec l’argent disponible, par la médiation d’un micro-climat. Sur ce point, je ne vois pas qu’il y ait des rapports avec les Siedlungen des années 30.
Vous avez réparti à Evora les matériaux dans une hiérarchie qui correspond à des fonctions précises: les agglomérés pour les aqueducs, les briques pour les transformateurs électriques, l’enduit blanc pour les maisons, le marbre pour certains lieux publics, etc …..
La construction des infrastructures était très importante parce qu’elles permettaient de configurer l’espace dès le commencement de donner une certaine identité au lieu et aux gens. Ces aqueducs devaient être moins chers ou au moins pas plus chers que des infrastructures normales. Il fallait donc un matériau qu’on puisse laisser brut, visible. Construire ces aqueducs en brique n’était pas possible parce que les briques ne sont faites ici qu’à un certain moment de l’année, séchée au soleil etc…. L’aggloméré n’est pas un très bon matériau, mais il n’y en n’avait pas d’autre. Il existait à Evora une petite production qui s’est énormément développée depuis le commencement de la construction de Malagueira. J’ai aussi pensé au contraste entre les maisons et les infrastructures, ce qui est une option esthétique qui évoque le contraste entre la pierre et l’enduit blanc de la ville ancienne. Par contre, récemment, j’ai pu utiliser la brique traditionnelle qui est très belle dans de petites interventions, comme les transformateurs électriques pour lesquels j’ai eu un budget suffisant parce que le financement venait d’un autre ministère. Il y a plusieurs exemples de ces bâtiments dispersés, construits avec les mêmes briques et quelques pièces de marbre, qui est un matériau local. Je les ai utilisés comme des signes qui, disposés pour des raisons de fonctionnement dans le paysage, créent une lecture de référence pour l’ambiance et apportent une touche de qualité sur le plan des matériaux. Plus tard, j’ai eu la chance de faire la digue en granit. Convaincre la municipalité a été difficile, parce que le granit devait être débité et taillé au nord et transporté jusqu’à Evora. J’ai trouvé que c’était très important de pouvoir mettre un matériau non local dans Malagueira, cela signifiait une augmentation d’urbanité, d’ouverture. L’utilisation de matériaux locaux n’est pas pour moi un principe, si un jour, je peux utiliser du porphyre, je serai très content évidemment. Je crois que ce qui m’intéresse dans la construction d’une ville, c’est sa capacité de transformation, quelque chose qui ressemble au développement d’un homme qui a, dès sa naissance, certaines caractéristiques et une autonomie suffisante, une structure de base, pouvant accueillir ou résister aux changements de la vie. Cela ne signifie pas une perte d’identité. Ce qu’on a construit à Malagueira, c’est comme le point zéro d’une ville ou plus exactement, non pas le zéro mais ce qui suit immédiatement le zéro. Alors, quand est arrivé le granit du nord, ce qui m’intéressait tellement, c’est que cette partie de ville avait déjà la force, la structure pour importer le granit et utiliser une main d’œuvre d’une autre région. De la même manière, dans l’évolution de la ville, un jour viendront forcément des éléments de dégradation mais qui peuvent également être des effets de la densité. J’aime beaucoup les villes de Chine, pour donner un exemple limite, où il y a tout cet apport superposé de panneaux avec des lettres etc.. Cela fait partie de la vie de ces villes, de leur urbanité. À contrario, j’ai fait ici, toutes ces maisons en blanc, quelque fois, non seulement les enduits, mais aussi les fenêtres, parce qu’il y a quelque chose que les architectes ne peuvent pas faire, c’est être eux-même variés et spontanés à l‘infini. On ne peut pas jouer à la spontanéité. Nous ne sommes pas spontanés, nous faisons des dessins, des études, des rapports, des propositions techniques… Mais un jour, j’ai vu à Evora la première maison où la couleur a été apportée. C’était un très beau jaune formant un soubassement. Ce jour là, j’ai été aussi heureux que lorsque j’ai vu la pierre venant du nord. Alors, j’ai la modestie de penser que cette ville aura des transformations successives comme toutes les villes, en bien et en mal, parce qu’elle existe comme une entité, avec son identité, sa force. Tout le monde me disait que l’idée du patio provoquerait des appropriations horribles comme ce que l’on voit dans les banlieues. Au contraire, quand on visite, on traverse les rues, les jardins sont habités, quelques jardins ont des fleurs, des arbres, d’autres ont des choses en plastique qui sont peut-être d’un goût épouvantables, mais c’est vrai que cela dépasse déjà beaucoup le contrôle du dessin, non pas parce que c’est chaotique ou irrationnel, mais parce que notre ambition est de faire une structure ouverte aux transformations qui puisse en même temps maintenir son identité.
Dans ce projet d’Evora, certains éléments suivent les courbes du terrain, d’autres forment des plans inclinés, ou au contraire des lignes horizontales. Comment s’organise ce rapport à la topographie ?
L’Alentejo est une région peu accidentée mais il y a des collines où beaucoup de villes se sont installées. Le quartier de Malagueira est à la base de la colline où est construite Evora et fait face à la ville ancienne avec sa cathédrale. Il y a toujours de très petites ondulations et il est normal pour les maisons de se poser directement sur le terrain pour simplifier les fondations. C’est aussi ce qui caractérise le paysage. Les formes géométriques horizontales qui se détachent de ce principe d’adaptation aux ondulations, correspondent à des évènements importants dans la division de l’espace. Par contre, quand à la fin d’une bande de maisons, on retrouve un espace ouvert qui regarde le paysage, là il y a quelque fois des formes qui s’imposent à la topographie, qui gagnent une certaine autonomie. Il y a des endroits où, pour des raisons de rapport avec le paysage, à cause de l’importance du programme, le lien avec la nature devient moins direct. Je pense que j’ai utilisé ces deux choses. Le sens transversal des rues est une logique générale par rapport à la question du drainage. Il n’y a pas de canalisations, toutes les rues suivent les pentes naturelles et conduisent l’eau jusqu’à un ruisseau existant puis jusqu’à la digue qui forme un plan d’eau. Les infrastructures, elles au contraire, se détachent du paysage et traversent les ondulations du terrain par des lignes horizontales ou inclinées, c’est une règle, sauf à un endroit où il y a eu une tragique erreur de construction.
À Malagueira et dans vos projets récents, vous semblez avoir abandonné l’usage de la couleur alors qu’elle était plus présente dans des projets plus anciens comme Sao-Victor ou Bouça.
Je dois dire que j’ai une certaine difficulté à manipuler les couleurs. Le problème se pose aussi quand on utilise les matériaux naturels, la pierre la brique, etc…. à cause de la combinaison avec leurs couleurs propres et leurs textures. Par exemple, on dit souvent que la banque de Vila do Conde est un bâtiment blanc en oubliant qu’il y a une grande surface de marbre légèrement rose. D’un autre côté, pour la faculté d’Architecture de Porto, j’ai beaucoup hésité à introduire la couleur parce que Porto n’est pas une ville où le blanc domine. Au début, le projet devait être tout en pierre, ce qui n’a pu être fait pour des raisons économiques. Il reste quand même deux tons dans la pierre du soubassement et pour les fenêtres sont peintes en ocre jaune clair. J’ai pensé utiliser le rose de la maison existante, mais j’ai préféré le blanc donne une autre présence à ce bâtiment qui apparaît entre les arbres. Peut-être que les parallelépipèdes de la faculté, qui ont des formes assez nettes, ne s’adaptent pas à une couleur unique ou même à des couleurs différentes. À Setubal, le contraste vient entre la pierre un peu ocre et le blanc des murs. Pour moi, ce n’est pas une option définitive, c’est une adaptation aux bâtiments. J’admire beaucoup les plans colorés extraordinaires des bâtiments de Barragan, ces patios avec des couleurs fortes, magnifiques, et je garde le souvenir exceptionnel d’un voyage, il y a vingt ans, dans les montagnes grecques, où il y avait des villages d’une couleur absolument magistrale, toujours foncée, ou bien la couleur de la Turquie avec ses sculptures peintes sur bois, ou celle des maisons très simples de Norvège. Je n’ai pas encore trouvé le site, ou la ville pour faire cela, mais je sens que c’est un secteur ouvert à la recherche.
Si l’on parle de la couleur, on ne peut éviter de parler de la lumière. Est-ce que vous parvenez, comme le fait Henri Ciriani, par exemple, à qualifier les différentes catégories de lumière.
Je ne sais pas répondre à cela parce que je travaille dans l’interdépendance avec la lumière naturelle. Pour moi, penser d’où, et comment vient la lumière, est la même chose que de penser le rapport entre un espace et un autre. À un espace étroit succède un grand et après un angle éventuel, on passe à un autre ou à un patio etc…Tout cela est accompagné intimement par la lumière, elle est indivisible de l’existence de ces espaces. Par exemple, je peux avoir besoin avant d’arriver au patio, d’une transition plus sombre comme en Afrique du Nord ou comme dans le sud du Portugal, où l’on n’a presque jamais des chambres avec des fenêtres directes sur un patio. Il y a les chambres, un espace de transition où la lumière est moins forte, et après le patio. Ou bien, on peut ressentir le besoin après avoir passé un espace de pénombre de trouver un éclat de lumière soudain. Si je ne sais pas qualifier cela, c’est que je ne suis pas capable de séparer la lumière des autres matériaux de l’architecture. Peut-être est-il important de traiter la lumière en soi pour des raisons de rigueur et de conscience de l’organisation de l’espace, mais je n’y ai pas encore réfléchi. Je n’ai pensé jusqu’à présent à la lumière, que d’une manière synthétique et synchronique. Par exemple, à Setubal, lorsque je travaillais sur cet atrium d’entrée qui est un espace long et à priori peu agréable, j’ai fait beaucoup de recherches pour le moduler et je me suis posé dans une certaine mesure comme un peintre qui met des signes, qui peuvent être un oiseau, un taureau ou je ne sais quoi, bref un ensemble de formes qui multiplient les rapports. Il y a l’ouverture sur la cour, et après dans la même direction, en haut comme une cheminée, un trou, une niche. A ce moment là des esquisses, j’ai concrétisé ces signes dans l’espace et j’ai trouvé que là devait être la lumière. Je la vois comme un des instruments dont est fait l’architecture, comme la couleur, par exemple, et que j’utilise dans un esprit de totalité, de globalité.
La question de la lumière est souvent réduite à l’idée de transparence apportée par les matériaux moderne.
Cette idée est un peu imaginaire parce qu’un bâtiment réalisé entièrement en verre apparaît complètement différemment suivant l’heure de la journée, suivant la manière dont arrive la lumière. Il y a beaucoup de bâtiments apparemment transparents, qui sont au contraire complètement opaques. Cette recherche de la transparence totale est une réduction parce qu’un bâtiment peut avoir des conditions internes et des conditions externes quelque fois opposées, des contradictions comme l’intimité et le besoin d’ouverture. C’est pour cela que je n’ai jamais fait un pan de verre total, je ne trouve aucun intérêt à cela. Un bâtiment est toujours fait d’éléments et de besoins différents qui exigent plus ou moins de lumière. Ce que je vois d’extraordinaire dans le progrès technique, c’est si je peux, quand j’ai besoin de verre formé de quatre épaisseurs, obtenir un dormant presque invisible et une plus grande vigueur dans le contraste entre l’opaque et le transparent, entre la lumière et l’ombre. Je ne crois pas que l’idée de transparence totale soit aujourd’hui importante pour l’évolution de l’architecture. Elle l’a été, quand Mies van der Rohe a fait aux États Unis, la petite maison de verre en continuité avec le paysage. C’était un moment de recherche sûrement très important.
On parle souvent à votre sujet des influences d’architectes comme Aalto ou Loos, mais finalement on peut sentir aussi qu’il y a une forte présence à Porto de l’architecture moderne anonyme dont le langage architectonique est devenu populaire et que l’on retrouve dans vos projets.
Oui, au Portugal, il y a des villes qui ont un rapport important avec d’autres régions d’Europe. Alors, je n’ai pas eu besoin de visiter Berlin ou Vienne pour connaître Mendelsohn ou même Adolf Loos. Leur influence est traduite dans la ville de Porto, sous une forme assimilée, assez solide parce que, comme vous le dites, elle respecte le décalage de la production et de la construction traditionnelle. Il y a des choses profondément influencées par l’architecture hollandaise des années 20 ou 30 mais avec un socle en granit qui n’existe pas en Hollande. On ne peut pas dire cela d’Aalto, qui lui a influencé d’une manière explosive plutôt les architectes dans les années 50. Ce thème des influences est beaucoup plus complexe qu’on ne le fait croire quelque fois. Les influences ont un énorme parcours, une seconde main, une troisième, il y a des superpositions à travers les territoires, des rencontres à distance. Il y a aussi des lignes de pensée.
Dans votre œuvre, il n’y a pas seulement des influences provenant de la culture architecturale, on y trouve également des rapport aux formes naturelles. Qu’apportent aux projets ces apparences morphologiques, les ressemblances à des animaux, à des visages?
L’influence de la nature dans le monde des formes de l’architecture n’est pas quelque chose de récent. Dans les villes italiennes on rencontre toujours des visages, on reconnait là deux yeux, une bouche sur le côté d’un bâtiment, cette référence au monde naturel sous une forme abstraite ou plus directe est une constante dans l’histoire. C’est peut-être un appui face au concept de proportion vis à vis duquel on a toujours une incertitude, même si nous pensons en dominer parfaitement les règles comme celles du nombre d’or. L’appel des formes naturelles a toujours rempli le monde des images, mais cela peut être aussi un élément de discipline. J’ai une certaine difficulté à faire une division bien séparée entre ce qui est abstrait et ce qui est organique. Il m’arrive de voir dans le château d’eau d’Aveiro comme une grande bête dans le paysage, avec une tête et un énorme cou de girafe. Pourtant, je travaille toujours à partir de la géométrie, c’est la discipline des formes abstraites géométriques qui rend possible la construction. Cela ne veut pas dire qu’à l’intérieur de cette géométrie, il n’y ait pas des renseignements qui peuvent venir directement du monde de la nature. Il y a toujours opposition et complémentarité entre ce qui est naturel et ce qui est construit. (1) “Musées” – p 66.
Propos recueillis en Décembre 1991 à Porto par Laurent BEAUDOUIN pour l’Architecture d’Aujourd’hui N° 278.
1994.
Pouvez-vous nous rappeler les origines du projet du centre Galicien d’Art Contemporain ?
C’est une commande de la province de Galice en ce qui concerne le musée et de la ville de Santiago de Compostelle pour le jardin. Le site est sur le terrain du couvent de San Dominico. C’est un édifice célèbre pour ses trois escaliers parallèles dont chacun donne accès à une porte, à un étage, le dernier finissant par ne donner accès à rien. Le jardin était en ruine, mais toutes les terrasses, toutes les fontaines, tout le système d’irrigation étaient encore enfouis et nous les avons mis à jour avec les archéologues. Quand j’ai commencé le projet, l’idée première du maître d’ouvrage était de reculer le musée et de le mettre à l’intérieur du jardin pour éviter la proximité du couvent. La ville de Santiago est très soigneuse de ses monuments parce que toute la ville est un monument. Cependant, en étudiant le terrain, je fus convaincu que je devais rapprocher le musée de la rue et ainsi, permettre une séparation claire avec le jardin. Jamais le couvent n’a été vu de loin comme un objet isolé, il a toujours été accompagné d’un mur de clôture. Mon argument a aussi été de dire qu’un centre culturel de cette importance ne pouvait être considéré comme une annexe d’un couvent où existait déjà un autre musée, celui du peuple de Galice. Évidemment, c’était une solution assez dangereuse parce qu’il n’y avait pas beaucoup de place et que le terrain est irrégulier à cet endroit. Le résultat inévitable, avec les 7 000 m2 du bâtiment, était une configuration triangulaire. Il a fallu ainsi concilier les particularités du programme et les contraintes de la parcelle. Il y a aussi un autre accident dans la configuration du terrain, au niveau de la courbe de la rue et de la rupture de pente, qui a produit une torsion du bâtiment. L’autre raison de la cassure est que la longueur du bâtiment paraissait démesurée par rapport au couvent, il fallait une fragmentation du volume. Par ailleurs, je tenais, comme une option personnelle, à une organisation des salles géométriquement régulière en carrés ou rectangles. C’est pourquoi j’ai constitué deux séquences d’espaces rectangulaires, deux bras séparés par un espace triangulaire. Cet espace est devenu un patio intérieur à double hauteur. À l’extrémité, j’ai accusé l’existence des deux volumes rectangulaires apparemment autonomes que j’ai articulé avec le porche de la façade de l’église pour organiser une sorte de portique d’accès au jardin. C’est un espace qui a nécessité un contrôle parfait de la géométrie. Par exemple, l’espace vide entre le porche de l’église et le musée forme un triangle équilatéral qui permet de constituer un tout entre la façade du couvent et les deux façades frontales du musée. Ensuite, je voulais trouver un équilibre tout en maintenant la proéminence de l’église dont la façade est plus haute, et le travail sur la pierre plus élaboré. Il fallait atteindre cet équilibre par d’autres moyens. Je l’ai obtenu par un effet d’échelle. Les façades du musée deviennent monumentales parce qu’il n’y a pratiquement pas de fenêtres. L’absence d’élément de mise en relation comme des fenêtres ou des détails à petite échelle permet au musée de trouver une force identique à celle des façades de l’église et du couvent. Enfin, un élément structurel dont on n’avait pas besoin à priori, apporte une force particulière à l’ensemble par la création d’une fente horizontale. Pour constituer l’entrée, j’ai disposé une plate-forme couverte qui s’articule avec la hauteur de la terrasse d’accès au couvent, formant ainsi un autre rapport d’échelle. Cette entrée est accessible par un escalier et se prolonge par une rampe sur la façade latérale le long de la pente de la rue parce qu’il y a des jours où le musée a peu de visiteurs et d’autres où ils viennent en foule à cause des pèlerinages. La rampe en creux forme alors un espace pour les abriter. À l’intérieur du musée, il n’y a pas de parcours privilégié. Il y a des alternances. Un des problèmes dans l’élaboration du projet est, qu’au départ, il n’y avait pas de collections et pas de conservateur. La seule solution était de faire un système très flexible avec des utilisations alternatives. Il y a un minimum d’espaces qui pouvaient être contextuels ou résiduels, mais au fond, même les espaces résiduels sont contrôlés par des différences d’échelle et suivent d’autres logiques comme, la pénétration de la lumière. L’autre moyen pour discipliner tout cela a été la recherche sur l’aménagement du jardin où, grâce à la découverte des terrasses, on a pu contrôler la topographie. Le plan du jardin semble irrégulier, il n’y a que des angles, mais l’étude de la topographie explique absolument pourquoi chacun de ces angles existe et les terrasses sont un moyen de contrôler les angles du bâtiment lui-même. Il y a dans la topographie, une succession d’espaces bien définis, à des cotes différentes qui se prolongent dans la séquence du bâtiment. Même la présence du système d’irrigation et des réservoirs a permis de donner plus de rigueur et de régularité au tout. À l’intérieur du bâtiment par contre, on n’a pas l’impression de complexité, on n’a pas la présence des angles. C’est assez régulier, assez tranquille. Dans le débat sur les musées, il y a beaucoup de polémiques sur le rapport entre l’architecture et ce qui est exposé. Le centre de ces discussions est la trop grande présence des bâtiments par rapport aux collections et cela se traduit, de la part des conservateurs, par une peur de l’architecture. Pour moi, les musées où je me sens le mieux sont ceux formés par des successions de salles avec des différences de hauteurs et de proportions, au sein d’espaces bien conformés où la lumière et l’atmosphère peuvent être parfaitement contrôlées. C’est une option probablement discutable, mais qui correspond à ce que je pense par rapport à cette polémique. Si j’avais eu plus de place, comme à Madrid ou à Helsinki, j’aurais certainement organisé une multiplicité d’alternatives, créant ainsi une atmosphère de labyrinthe. C’est la combinaison d’une grande clarté et d’une relative indéfinition dans l’utilisation de l’espace qui laisse plus ouverte la découverte de la totalité du musée.
Finalement, par la façon dont vous décrivez ce bâtiment, on a l’impression que la géographie remplace l’histoire comme source de création. Vis-à-vis du problème de la forme, vous répondez en géographe.
Évidemment, c’est une discipline qui m’intéresse depuis toujours, mais aujourd’hui, j’en suis devenu plus conscient. Je ne dirais pas remplacer, mais compléter. La géographie et l’histoire ne sont pas à l’opposé, leurs rôles se complètent. C’est difficile et prétentieux, mais je voulais une espèce d’atmosphère qui aille au-delà du style ou des styles. Il y a déjà une présence matérielle majeure dans le granit utilisé partout à Santiago, mais ce n’est pas seulement ça. Il y a un rapport intense, toujours sensible aujourd’hui, avec l’Amérique du Sud qui apporte un certain exotisme et une certaine géométrie des formes, qui font qu’une part de l’illuminisme sud américain revient à la mémoire. Cela se superpose au maniérisme, au gothique, au roman, etc … Je ne peux pas décrire exactement le résultat, mais j’en suis convaincu parce que j’ai visité Santiago intensément et que je trouve le bâtiment naturel dans le paysage. J’ai la prétention de penser qu’il y a quelque chose de plus général, référencé à l’ensemble de l’histoire et non pas une époque et que cela affecte le résultat du bâtiment. Ainsi, cela ne signifie pas une distance envers l’histoire, mais peut être un essai de synthèse.
Pouvez-vous préciser votre pensée sur la question de l’éclairement des salles ?
La chose qui me trouble le plus lorsque je visite un bâtiment, et spécialement un musée, est la quantité de choses qui, aujourd’hui, perturbent l’espace. Cela s’est renforcé lorsque j’ai visité l’aéroport de Foster à Londres que j’ai trouvé merveilleux. Je me suis demandé : “Mais pourquoi les aéroports sont-ils tellement horribles ? Et pourquoi ils peuvent être beaux comme celui-là ?” J’ai regardé, c’est simple. Le plafond est propre, pas de détecteurs, d’appareils qui se salissent, pas de plafonds démontables qui se dégradent, etc … J’ai essayé d’atteindre cette pureté et cela m’a demandé de grands efforts pour vaincre la quantité d’obstacles et réduire l’influence de tous ces systèmes de sécurité, de ventilation, de lumière, etc … J’ai utilisé un système de plafond suspendu englobant toutes ces machines d’où sort la lumière naturelle, et l’éclairage artificiel utilisé en renforcement. C’est peut-être une erreur, mais je suis convaincu de l’inutilité des projecteurs pour éclairer les peintures. La lumière réfléchie, indirecte, diffuse, est la forme la plus naturelle et la plus proche de la lumière du jour. À Santiago, j’ai dû accepter un compromis pour permettre d’installer des projecteurs, mais lors de l’exposition d’inauguration, personne n’a senti le besoin de les utiliser. Il y a cependant une salle à double hauteur avec une passerelle technique pour permettre des installations spécifiques.
Le plafond suspendu que vous utilisez ici, inverse l’impression de gravité, il est comme une table renversée.
Oui, il y a un composant formel. L’image de la table renversée est venue parce que je n’étais pas satisfait d’une simple suspension. J’ai voulu transformer le principe dans une proposition spatiale et formelle qui est même un peu violente, mais l’effet de la lumière diffuse dématérialise la lourdeur possible du système. Évidemment, les pieds de la table projettent des ombres, mais ce ne sont pas des ombres fortes. Les ombres sont diffuses aussi, mais je voulais ça, je voulais cet effet, j’étais content avec cet effet. Comment l’expliquer ? Je ne voulais pas faire une chose aseptisée, je voulais proposer une salle avec une forme. Je trouvais qu’il est important pour le musée de faire une proposition d’architecture qui ne soit pas d’une totale neutralité. Un conservateur m’a dit que l’important est qu’un musée ait du caractère et qu’il respecte ce qui est exposé. Dans un musée d’art contemporain, les artistes ne doivent pas trouver un vide, au contraire, c’est l’existence d’un espace caractérisé qui développe une réponse esthétique nouvelle, innovatrice. C’est une idée qui plaît évidemment aux architectes parce qu’elle accepte l’architecture. C’est une idée contextuelle qui va au-delà du contexte, expression devenue un peu méprisable, galvaudée parce que l’idée va au-delà du mot.
Ce qui est étonnant avec les tables de lumière de Santiago, c’est que vous faites l’inverse du dispositif de la salle d’exposition de la faculté d’architecture où le disque du plafond semble flotter comme un miracle et où la structure est absolument invisible. Cela pourrait paraître contradictoire si nous n’étions pas habitués à ce type de surprise dans votre travail.
Mon intérêt pour l’expérimentation est un défi que je ne peux pas m’empêcher de suivre. Je projette actuellement deux musées de plus et dans les deux cas, je propose des alternatives à ce système. Au fond, le point de vue est le même, la lumière diffuse. Mais, dans le détail et sur le plan formel, il y a une quantité de variations. Je suis incapable de trouver que la recherche peut finir sur le thème de la lumière. D’un autre côté, en architecture, toutes les choses sont liées. A Santiago, l’existence de cette forme-là est liée à une quantité de choses dans le projet. Par exemple, si l’on regarde le caractère de ces deux façades pratiquement sans fenêtres, géométriquement exactes, c’est le même corps de formes, c’est le même organisme. Le rapprochement de ces formes n’est pas simultané. Il y a des recherches sur la forme extérieure qui dépendent de choses qui sont à côté, ou au-delà, etc … .Ce n’est pas le caprice, c’est la complémentarité entre tous les éléments qui exigent que l’on cherche d’autres chemins, d’autres voies. Ce qui fait le caractère d’une œuvre, même s’il y a des contradictions brutales, c’est de permettre de ressentir, de mémoriser les choses tout au long du parcours. La mémoire permet de ressentir un rapport avec tel élément ou tel autre, avec ce qui est au-delà, ou avec la lune dans le ciel. La description, l’interprétation, l’explication ne finit jamais, il manque toujours quelque chose. L’important est de chercher à tenir tout dans la main et d’être en rapport avec tout.
C’est pourquoi l’entrée du musée est aussi comme une table.
Oui, c’est vrai, c’est un tout ou une partie d’un même tout, déjà absorbé par le couvent d’à côté, par le jardin et par le profil du paysage. L’entrée se fait en montant la rampe sans voir le paysage parce que les murs sont hauts, arrivé sur la plate-forme. Soudain vient la vision du terrain. Le profil de Santiago exige cette ligne horizontale nette, ces choses sont liées.
La résolution d’un problème à tel ou tel endroit peut avoir des conséquences depuis l’ensemble jusqu’au détail de construction.
Oui, avec le danger de paraître métaphysique. “Dieu est dans le détail” dit Mies van der Rohe. Qu’est-ce que cela veut dire? Le tout est dans le détail et le détail dépend du tout.
Pouvez-vous expliquer la forme un peu étrange de la rampe et de son plafond ?
C’est un mouvement d’ascension qui est en rapport avec le poids des bâtiments d’à côté. Une ascension renforcée par le mouvement du plafond, plus que de la rampe et confortée par la vision progressive de l’intérieur. Au début, on voit seulement le toit et petit à petit, on sent la présence de l’intérieur du bâtiment, parce que l’on voit à chaque pas plus loin à l’horizontal, on découvre la profondeur de l’espace intérieur. En arrivant à l’entrée, on connaît déjà certaines caractéristiques du bâtiment, sa grande dimension et la thématique du parcours. L’effet est que l’on marche presque à l’horizontal parce que la rue est en pente, ainsi ce mouvement n’entraîne pas d’effort, on n’a pas l’impression d’être dans une rampe, on croit que c’est la rue qui descend. Ce parcours a besoin de se stabiliser, pour cela, la courbe du plafond se finit comme une enveloppe. Il y a aussi une ouverture qui donne l’idée que c’est habitable. C’est devenu une fenêtre pour le directeur, comme ça, il peut voir s’il y a du public où s’il n’y a personne… Lorsque j’ai commencé le projet, je n’avais que des fragments d’idées et je n’ai rencontré la logique du bâtiment que petit à petit.
(Luis Mendes) : Cette rampe est assez énigmatique. Je me souviens du moment où cette forme est apparue la première fois sur la planche à dessin. C’était entre 2h30 et 3h00 du matin et l’on rendait à 8h00. Je travaillais sur les coupes et j’ai demandé à Siza : “Qu’est-ce qu’il se passe là ?” Siza est venu et il a fait ça … On passe le dessin à l’encre et cette forme est encore là, comme si elle était complètement réfléchie, elle n’a pas changé.
Je l’avais fait à la maison pour les impressionner.
En ce qui concerne la muséographie, est-ce que vous pensez que les œuvres doivent être fixées au mur, ou peuvent-elles être accrochées à des cimaises autonomes, libres par rapport à l’espace du musée.
Je préfère toujours voir un tableau contre le mur d’une salle. Là, je suis assez conservateur. Il y a d’autres expériences contemporaines où le problème est tout à fait différent. Par exemple, j’ai été impressionné par le musée du Saò Paolo où il y a une superposition des époques, dans des panneaux de petites dimensions en verre suspendu, et l’on peut voir juxtaposé un Léonard de Vinci et un Van Gogh, mais cela a beaucoup à voir avec la société, l’atmosphère d’un pays nouveau, plein de possibilités, de potentialités, mais avec aussi, un grand désir de liaison avec l’histoire et le passé. C’est une nébuleuse de culture qui m’a semblé féconde dans cette circonstance. Mais je ne penserai jamais faire, à Lisbonne par exemple, un musée avec des cimaises en verre. On ne peut pas séparer le musée de la ville du moment historique, du moment culturel.
Avez-vous essayé d’introduire le thème de la couleur dans ce projet ?
J’ai beaucoup de problèmes avec le thème de la couleur. J’ai été confronté à ce problème avec les matériaux, le marbre de telle ou telle couleur, la pierre, la brique, etc … Pour la couleur artificielle, disons la peinture, les choses vont au-delà de la subjectivité ou de la recherche esthétique d’un architecte. Par exemple, l’extraordinaire performance de Barragan avec la couleur, ne peut être séparée de la réalité des traditions du Mexique et des usages de vie, aujourd’hui perdus. Barragan utilisait des couleurs naturelles qui se dégradent et refaisait à chaque fois, une couleur différente. C’était une forme de vie, une partie de l’existence de cet homme. Il en résulte des discussions perpétuelles pour restaurer les œuvres. C’est impossible ! Quelquefois, je peins en blanc, non pas parce que je suis puriste, mais parce que je ne trouve pas les raisons pour faire autrement.
Il y a pourtant, dans votre œuvre, des couleurs fortes, le vert d’eau de Saò- Victor, l’ocre rouge de Bouça, l’ocre jaune et le bleu de la maison de votre frère.
Là, j’ai trouvé des raisons fortes. Je ressens très bien un manque dans cette direction et si j’ai un minimum de raisons, j’essaie de faire une proposition réelle. Mais c’est un problème plein d’ambiguïtés, lié à l’artificialité du processus de construction de la ville, à la délégation des responsabilités, au manque de vie urbaine. Cette manifestation des couleurs a une histoire, mais aussi une dimension existentiellement subjective qui, aujourd’hui, nous manque. A Saò Victor, ce n’est pas par hasard si j’ai utilisé les couleurs, c’était un projet participatif au cœur d’une situation révolutionnaire et conflictuelle. Ce n’est pas par hasard qu’il y ait eu cette explosion de la couleur pendant la révolution russe, sur les trains, lors des représentations théâtrales populaires, etc … C’était un moment d’explosion, la couleur est une explosion aussi.
Ressentez-vous le besoin de changer des choses en cours de chantier comme le faisaient Le Corbusier ou Luis Barragan?
J’ai eu la possibilité et l’exigence de faire de nombreuses visites de chantiers, au moins une journée chaque semaine. J’avais aussi des entreprises et un maître d’ouvrage décidés à obtenir le maximum du bâtiment. Rien ne peut remplacer l’expérience pas à pas du développement des espaces. Ces découvertes permettent d’envisager, non pas des changements, mais surtout des approfondissements des rapports entre les espaces. Mais je souffre constamment aujourd’hui parce que cela devient de plus en plus impossible. Les détails préétablis ne peuvent remplacer la richesse d’ouverture de l’expérience graduelle d’un bâtiment, mais pour cela, il faut avoir un contrôle rigoureux préalable, il faut que les détails soient étudiés, il faut que le planning soit bien aménagé, après, cela ouvre des possibilités d’aller beaucoup plus loin. Sans ce contrôle préalable, il y a des difficultés à introduire des découvertes nouvelles. Dans la structure actuelle, c’est de plus en plus difficile et cela explique que nos œuvres sont d’une certaine pauvreté si l’on songe aux œuvres du passé. Ici, j’ai eu cette possibilité, j’ai changé des détails, j’ai ouvert des fenêtres ou j’en ai agrandi la hauteur, j’ai abaissé le toit, j’ai pu faire des essais grandeur sur place. Si cela n’existe pas, il y a une dimension de l’architecture qui est perdue.
Votre travail ne passe pas seulement par la contemplation visuelle. Il y a une expérience physique de l’espace, une relation corporelle globale. Comment pouvez-vous la contrôler.
Je ne peux pas tellement vous répondre. Quand je développe un projet, je dois avoir la possibilité de faire tous les parcours intérieurs du projet en imagination. Le dessin, la maquette, l’esquisse ne suffisent pas. Ce sont des instruments tièdes. L’important est de fermer les yeux et de se sentir se promener dans le bâtiment en suivant des sensations différentes. On parle souvent des esquisses à propos de mon œuvre, mais au fond, je pense que c’est une espèce de faiblesse. Si seulement je pouvais ne faire aucun dessin, imaginer simplement le bâtiment et le transmettre dans un ordinateur. Il faut contrôler l’espace dans les trois ou quatre dimensions. Il faut faire des maquettes, des esquisses des points de rencontre, ou si l’on est assez fort, on peut le faire seulement dans son esprit. Moi, je ne peux pas le faire, mais je pense qu’il y a des gens qui peuvent le faire. J’ai beaucoup essayé d’aller au-delà de la géométrie, être spatial en trois ou quatre dimensions.
A Santiago, même si la géométrie des salles est simple, on a un des espaces les plus complexes que vous n’avez jamais fait. Avez-vous plus de facilité aujourd’hui à concevoir ce type de spatialité qu’autrefois ?
Non, dans une certaine mesure, j’ai plus de difficultés, j’ai beaucoup travaillé sur ce bâtiment, avec des périodes de panique parce que le temps passait et que je ne trouvais pas l’ordre des choses., Autrefois, avec plus d’inconscience, je pense que j’arrivais à des résultats intéressants en souffrant moins. Peut-être que je suis un peu vieux pour avoir cette capacité sans un grand effort. Mais, il y a aussi une autre exigence, avec cet effort, je peux arriver à une autre cohérence, plus lumineuse peut être. L’architecture n’est jamais plus facile, elle devient de plus en plus difficile, les moments où l’on rencontre une joie spontanée sont plus rares. Je dois dire que c’est plus facile de rencontrer cette joie en travaillant au Portugal, dans un petit village qu’à Lisbonne, en Hollande ou à Paris.
(Luis Mendès) Il y a dix ans, Siza nous a fait une explication du projet à Berlin et nous avons parlé du projet de James Stirling pour le Wissenchaftzentrum, et je me souviens de Siza nous disant : “Cela a l’air simple, mais regardez la complexité et les transitions entre les différents volumes”. Ce sont les moments les plus aboutis, les plus dramatiques. C’est le cas aussi du projet de Louis Kahn pour le couvent des Sœurs Dominicaines.
Ce sont toujours les points difficiles qui sont les plus déterminants. Ces difficultés donnent la tonalité du projet jusqu’au détail. C’est vrai que j’avais oublié cela, le projet de Stirling. Beaucoup de gens l’ont critiqué, mais c’est un projet, à mon avis, extraordinaire. J’ai été très impressionné, très touché par ce thème de l’interpénétration de corps différents. Cela, on va le rencontrer aussi dans l’architecture classique, par exemple, à la Villa d’Hadrien, ou dans les plans de la Rome ancienne. C’est dans ces points où peuvent surgir des confusions qu’il faut contrôler, à la fois en plan, et en section, en relation avec les perspectives, les axes et les transparences. C’est une spécificité que l’on ne peut maîtriser seulement avec la géométrie du plan.
Dans votre travail, la forme n’est jamais la première question. On a l’impression que vous n’avez aucun complexe, aucun à priori sur la forme. L’aspect final semble n’être que le résultat d’un lent processus de maturation et jamais un point de départ préoccupé par le souci de la beauté.
On ne peut pas généraliser. Par exemple, lorsque j’ai fait la maison à Ovar, le site était assez pauvre, alors j’ai utilisé une forme de départ utilisant des références qui ont été mentionnées par la critique. Dans une ville aussi riche que Santiago, on ne peut s’empêcher de faire le plongeon dans l’histoire de la ville avant de pouvoir un jour, mettre la tête à nouveau hors de l’eau. Alors, on s’aperçoit que l’on peut respirer parce que l’on a passé toutes ces expériences.
Vous préparez un second musée dans la partie haute du jardin.
Oui, en haut, j’ai fait un projet pour un restaurant qui est terminé, mais on m’a proposé de faire là, le musée de la fondation Eugenio Granell qui est un des grands peintres surréaliste espagnol qui s’est exilé après la guerre civile. L’Espagne était une source d’innovations à cette époque, dans la peinture, la littérature, la poésie. Ce musée est un problème tout à fait différent parce que la collection existe. La possibilité de faire un autre musée avec la connaissance que j’ai aujourd’hui du jardin sera une expérience extraordinaire et stimulante.
Propos recueillis à Paris par Laurent Beaudouin et Luis Mendes en Janvier 1994.




